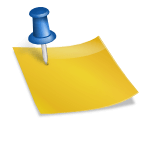Amélie Doucet (2025)
J’ai posé ma valise, près de la table joliment décorée. Un vase japonais dont le vernis rose pâle craquèle légèrement, un bloc-notes aux pages bleu ciel, une bouilloire à l’ancienne, des sachets de thé ou tisane, des dosettes de café certainement faible. Dans le vase délicat, orné de branches d’arbres très fines, flotte un seul iris. Un iris sauvage de Finlande. J’ai vérifié sur l’application de mon téléphone portable qui m’a spécifié de quelle sorte d’iris, il s’agit. Il est noté, de plus, que le genre iris contient deux cent dix espèces et d’innombrables variétés horticoles. La fleur, que je contemple, est d’un jaune vif flamboyant. Elle prend place dans la chambre, à sa façon. Son odeur est discrète. Légèrement boisée et elle participe à l’atmosphère agréable de la pièce. Je continue mon exploration de la table. Sur celle-ci, il y a une coupelle de porcelaine garnie de spéculoos emballés dans des étuis individuels, et pourvue de six ou sept carrés de chocolat belge. Coincé sous la coupelle, un stylo-plume, très fin et sobre, attire mon attention. À cet instant, je ressens une impression indescriptible. Ça me met mal à l’aise. Or, la pièce possède une chaleur humaine, laquelle contraste fortement avec l’accueil maussade, voire glacial du réceptionniste de l’hôtel. Dans la salle d’eau attenante à la chambre, le décor est d’un blanc banal, classique. Lorsque je reviens près du lit et de la table, elle est là. Vêtue d’un chemisier jaune et d’un pantalon vert buisson. Son regard semble me transpercer. La jeune femme regarde par-delà mon corps. J’ignore comment dire ça, autrement. Alors, je sors de mon état de sidération.
— Madame, vous vous êtes trompée de chambre ? Vous faites erreur, je…
— Pourquoi me répètes-tu ça chaque jour, mon chéri ? Ça me blesse, si tu savais…
— Euh… Madame, tout va bien, dites-moi, il y a un souci ? M’entendez-vous ?
Elle m’ignore superbement, ne paraît pas me voir ; elle s’assoit sur le lit couvert d’un plaid moelleux et beige élégant. Je fais un pas vers elle, mais elle ne réagit pas, ne sourcille même pas. Me voit-elle ? Son regard ne rencontre pas le mien. C’est comme si je parlais à un fantôme. Elle s’étire sur le lit, masse langoureusement ses pieds, d’un geste terriblement féminin. Je lui dis qu’elle ne peut pas s’inviter de cette façon ; dans ma chambre et prendre ses aises. J’ai à peine le temps de terminer ma phrase. En effet, la voix d’un homme surgit. Une voix impatiente : « Tu me fatigues, Iris ! Tais-toi, ça me fera des vacances. Hé oui, tu devrais faire un régime ; je te dis ça parce que c’est vrai, tiens ! »
Qui sont ces êtres ? Je me blottis contre un mur. Je sens mon pouls galoper, je commence à transpirer et je halète comme un animal pris au piège. Qui est cet homme, tout près de moi, qui parle sans que je le voie ? Il est absolument invisible ! J’ai dû basculer dans un autre univers que le mien. Un autre temps. Ou alors, il y a une explication plus terre à terre : je deviens fou. J’essaie de me raisonner, de garder mon sang froid. L’homme appelle la jeune femme, Iris. Iris, comme la fleur unique flottant dans le vase sur la table. Elle ôte son chemisier jaune vif et dévoile son caraco blanc. Ses bras sont potelés comme ceux d’un poupon. Sa peau semble transparente. Je coulisse littéralement sur le mur et me fonds dans le rideau lourd et rouge écarlate de la fenêtre.
— Alberto, mais ne me secoue pas comme ça. Tu me fais mal. C’est bon, je me rhabille, ainsi tu ne verras pas mes kilos en trop. Je fais ce que je peux, tu sais. Et, puis, ça ne fait pas si longtemps que j’ai eu la petite, il faut me laisser du temps, pour accepter tout ça…
— N’exagère pas ! Pour Camille, ça fait plus de deux ans maintenant ! La vérité, c’est que tu ne fais aucun effort. Le psy, le coach sportif et le reste, ça n’a rien donné… On a prévu des vacances sportives. Enfile donc ton jogging, on va marcher. Faut aller de l’avant, la vie, c’est comme ça !
Iris rabat ses jambes contre son torse. J’observe ses mains qui se crispent sur le pantalon vert. Elle penche la tête et j’entends ses premiers sanglots. Discrets, au début, puis de plus en plus sonores. Ensuite, elle se lève, s’essuie le visage, se mouche violemment dans un mouchoir en papier extirpé de son sac, fait les cents pas dans la chambre. Elle dit d’une voix étranglée que Camille lui manque. Que cette idée d’hôtel, dans ce coin perdu, est une mauvaise idée.
— Si on rentrait chez nous, Alberto. Je t’en prie, tu sais bien que je ne veux plus quitter la maison, ça me stresse d’être ailleurs ! Implore-t-elle, sans succès, visiblement.
La voix de l’insensible Alberto s’est tue, mais j’écoute son silence. Épais, pesant. Il envahit tout l’espace de la chambre. Au bout d’un moment suspendu, il prononce calmement comme un juge le ferait énonçant sa sentence : « Camille est morte. Ne parle plus d’elle. Laisse le passé là où il est. Tu regardes devant, maintenant. » Malgré moi, je suis spectateur de la scène conjugale et surtout de la glaçante réalité qui vient d’être révélée. L’homme est toujours là sans être objectivement là. Je perçois sa présence, j’entends sa voix ou ses silences, mais je ne le vois toujours pas. J’ai mal pour Iris, pourtant que faire ? Mes pensées se bousculent. Des idées en éruption. Cela fuse de tous côtés. Une migraine insupportable s’est invitée dans ma tête : mes tempes palpitent si fort que je sens que mon crâne va éclater. Dans l’expectative de l’explosion, je serre les paupières. J’ignore combien de temps exactement ; nous restons ainsi, en apesanteur, tous les trois. Lorsque je rouvre les yeux, Iris et Alberto se sont évaporés. Je suis face à face avec moi-même. Pour faire baisser la tension encore palpable dans l’air, je prends machinalement un petit chocolat belge dans la coupelle, sans l’ouvrir. Je tire brutalement le rideau et regarde dehors. Rien n’a changé. Ma Ford dort sur le parking, entourée des voitures des autres voyageurs. Un tourbillon d’humidité semble s’échapper du bitume de la route. La Lune habille la nuit de son halo mystérieux.
— Le chocolat belge n’a pas son égal. Cependant, comme tous les chocolats, il supporte mal la chaleur, jette quelqu’un, d’un ton paisible, dans mon dos.
Je me retourne sans réfléchir. Le petit homme moustachu se trouve près de la table de nuit, une main négligemment posée sur le chapeau gris poreux couvrant son crâne chauve. Il s’incline légèrement pour me saluer. À l’ancienne. Interloqué, je regarde le carré de papier gris froissé, réchauffé dans ma paume. Cette fois, c’est décidé, j’appelle le réceptionniste. Cette chambre me rend dingue, j’en veux une autre ! Je saisis le combiné, mais il s’effrite littéralement entre mes mains, tel un téléphone de sable. Je tente de m’extraire de cet espace. Je me précipite vers la porte. La poignée est bloquée ! J’ai beau la malmener. Rien à faire, je suis coincé, ici. À court d’idées, je suis sur le point d’interroger l’homme, mais il ne m’en laisse pas le temps.
— Il faut résoudre cette énigme.
— Mais enfin, qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré dans ma chambre ? Quelle énigme, de quoi parlez-vous donc !
Je commence à sortir de mes gonds. Et, ma colère se concentre sur ce petit bonhomme vêtu de gris, de la tête aux pieds, qui est le sosie parfait d’Hercule Poirot, le personnage emblématique d’Agatha Christie. Belge comme le chocolat. Je réalise soudain qu’il est apparu tandis que je prenais en main le carré de chocolat, tout comme Iris a surgi dans ma chambre exactement au moment où je contemplais la fleur du même nom dans le vase. Dans cette chambre, les objets présents sur la table prennent vie. C’est complètement fou, mais bien réel ! Le petit détective poursuit, nonchalamment : « Il faudrait savoir ce qui est arrivé à la petite fille d’Iris. Sa mort n’est pas un accident, n’est-ce pas ? » Je rétorque : « Je ne sais pas qui vous êtes ni quel est le rôle d’Iris dans cette histoire. Tout ce dont je suis sûr, c’est que j’ai pris cette chambre d’hôtel afin d’être au calme et pour trouver l’inspiration pour mon roman. Mais, que me voulez-vous à la fin ? » Hercule sourit sans répondre. Un large sourire. Il me scrute ensuite d’un air goguenard. Son mutisme est insupportable. Après un long moment, figé dans le temps, je décide de m’asseoir sur la chaise, contre la table qui pourrait faire office de bureau. Je prends ma tête entre les mains, ferme les yeux. Puis je les rouvre et aperçois le stylo-plume coincé sous la coupelle de porcelaine. Hercule s’approche jusqu’à me frôler, se penche vers moi et me glisse à l’oreille : « Vous voyez bien que vous avez besoin d’aide. Tout écrivain, même le plus médiocre, a besoin d’Hercule Poirot, pour explorer, de sa plume, l’infini des possibles. Créer pour son lecteur l’énigme d’un temps, sans l’aliéner. Vous avez choisi la chambre comportant le thème : Écrire une histoire. Je pensais que les choses étaient limpides, pour vous, lorsque vous aviez effectué la réservation. »
ANGIE RODRIDE.
Texte publié dans le No 44. Motel 666