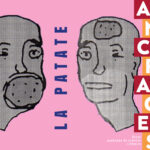Faniriantsoa Milanto Harivony Rakotoarison (2025)
La clé est froide contre ses doigts. Elle laisse, entre ses phalanges, un film gras et une odeur minérale, presque sanguine, qui s’éternisera. Devant elle, la porte donne des airs accueillants. La peinture écaillée montre une multitude de couleurs, comme les cernes de croissance des arbres. Le numéro de la chambre est complètement illisible, une invitation à plonger dans l’inconnu. Ça ressemble presque à « = ». Un 11 tombé sur le côté ? Un 17 ?
=
La fin d’une équation. La consécration d’une histoire universelle, d’une relation inévitable entre différents éléments qui, ensemble, bâtissent quelque chose de nouveau.
=.
La multiplication de mauvaises décisions avec l’addition d’un certain penchant pour le drame =
… maintenant. La clé à la main, la porte aux multiples couches.
Autour d’elle, d’autres humains font leur propre équation, dont le résultat est curieusement similaire au sien.
= maintenant, devant une porte à ouvrir.
Elle glisse la clé dans la serrure bien huilée. Clic. D’un simple coup de poignet, la porte s’ouvre devant elle. Au lieu de s’ouvrir dans la chambre, comme la majorité des motels, cette porte donne sur un long corridor recouvert d’un tapis vert élimé. Une odeur ronde et sucrée lui monte aux narines et lui emplit la tête, comme le glaçage d’une brioche à la cannelle qui vous tapisse les gencives.
Elle tend la main pour prendre son sac, le seul, et se surprend presque à le trouver si léger. Elle a cru pendant longtemps aux bienfaits d’une vie sans matériel. De pouvoir partir et arriver en quelques minutes avec un simple sac à dos. Mais de légère, elle est devenue immatérielle. Invisible. Comme une brise qui ne laisse pas de trace.
Elle se retient de ne pas se retourner pour jeter le sac à bout de bras — assez fort pour déplacer l’air, assez fort pour créer une brise. Au lieu de quoi, elle fait un premier pas à l’intérieur, et un deuxième. La porte se referme derrière elle. Le tapis sous ses pieds commence déjà à absorber l’eau et les débris laissés par ses souliers. Elle enlève le premier et le deuxième avec le gros orteil. Son sac pend au bout de son bras, prêt à s’envoler.
« Ha te vlà ! About time ! »
La lumière qui provient de la pièce au bout est en partie bloquée par un corps menu, mais plusieurs rayons transpercent la dentelle semi-transparente formée de bouclettes blanches qui s’élancent dans tous les sens pour former une auréole. Elle est plus jeune que dans son souvenir. Elle la regarde de ses grands yeux noirs aux paupières continuellement roses capables de vous envelopper l’âme comme une couverture de laine.
« Allô grand-m’man. »
***
L’intérieur de la pièce est chaud et invitant. Des souvenirs d’enfance l’envahissent. Le chemin de terre qui les envoie valser dans tous les sens alors que la Honda Civic fend la neige. La pente qu’on doit monter avec les bagages — un pas devant, un demi-pas derrière, un pas devant… La porte de bois lourde qui s’ouvre sous ses petites mains, l’odeur moite et humide qui émane des mitaines, des tuques et des bottes entassées à l’entrée. Le corridor orné d’un tapis qui mène vers la pièce principale. L’odeur de sapin, du vieux cuir, de la tourtière qui refroidit sur la table. Le feu dans l’antre dont les crépitements chatouillent l’estomac et la tête.
Elle se laisse tomber sur le fauteuil le plus près comme elle le faisait enfant ; sans retenue. Elle est légère. Les larmes lui viennent presque aux yeux. Sa chambre de motel a des airs de chalet.
Le petit appartement de sa grand-mère à Moncton avait toujours été un refuge tapissé par l’odeur invitante de la nourriture maison et la douceur des couvertures tricotées à la main. Comme à l’époque, elle l’entend s’affairer derrière elle. Le motel n’a pas de cuisine complète et pourtant, quand elle tourne la tête, c’est pour voir sa grand-mère déposer devant elle les mêmes petits fours avec lesquels elle l’accueillait à l’époque. Elle renifle doucement — son gosier se remplit de l’odeur du thé noir et de la vanille, comme une vague qui descend ensuite jusqu’à son estomac.
Après avoir délicatement placé les assiettes et les tasses en porcelaines sur la table de salon, sa grand-mère se relève délicatement et replace le coussin sur le fauteuil derrière elle. Elle s’installe dans l’espace maintenant libéré. Son corps mince ne prend jamais plus de place que nécessaire. Elle sent la fleur d’oranger et le parfum à la fois âcre et sucré de la vieillesse.
Elle n’a pas pris une ride depuis sa dernière visite, il y a dix-sept ans. Elle porte toujours la même chemise pour homme en flanelle dont le bleu cobalt fait ressortir le vert de ses yeux. Ses poignets sont ornés de bracelets délicats qui tintent et soulignent ses mouvements lents et posés d’une douce mélodie. Ses cheveux s’éloignent de son crâne dans tous les sens, les boucles parfaitement formées cherchant à toucher le ciel et les étoiles.
Une dentelle pour les astres.
Sa grand-mère a toujours donné l’impression de léviter à quelques pas du sol, d’une légèreté qui ancre.
« Ça fait un boutte. »
Sa voix est flûtée, comme un rayon de soleil passant à travers le verre d’une coupe. Elle prends une des tasses de thé. La chaleur se répand entre ses deux paumes et irradie jusqu’à ses épaules. Le thé noir est musqué, amer. Son odeur emplit les narines pour monter doucement jusqu’au cerveau. Elle prend quelques gorgées. La chaleur est autour d’elle, en elle.
Elle tend la main, prend un des petits fours et l’avale d’un coup. Le fromage à la crème légèrement durci laisse une amertume sur son palais et se glisse entre ses dents. La vanille explose ensuite comme une grande bulle qui lui remplit les narines. Les ingrédients, encore tièdes, se combinent parfaitement sous l’enrobage refroidi du glaçage.
Elle tend la main vers un deuxième four, qu’elle déguste plus lentement cette fois. En deux bouchées. Son estomac ne se rappelle pas la dernière fois qu’elle a mangé — les souvenirs des derniers jours emprisonnés dans un emballage de repas congelé. Elle ferme les yeux, espère pouvoir repousser le plus possible la conversation qui plane entre leurs deux corps, loin de leur chaleur.
La voix de sa grand-mère s’élève, flottant au-dessus de sa tête comme des volutes de fumée.
Elle se referme. Elle rejette cette discussion depuis dix-sept ans. C’est une porte qui prendra du temps à ouvrir. Soudainement, il lui vient à l’esprit qu’elle ne se souvient même pas si sa grande-mère est encore en vie. Pourtant, sa voix est là, tout autour d’elle. Une voix qui réveille les bêtes enfouies dans leur tanière et dont le grondement se mêle à l’histoire.
Quand elle ouvre les yeux, elle est de retour dans sa maison d’enfance. Elle est assise à la table de cuisine. Son coude droit colle à la table alors que, de l’autre main, elle pousse les miettes de pain durcies d’un déjeuner déjà oublié. Il n’y a plus de pain depuis au moins mardi. L’assiette devant elle aborde différents tons de beige.
« Ben mange ! »
Sa mère est derrière elle. Comme un typhon, elle touche tout ce qui l’entoure. Tout autour, ça s’entrechoque, siffle, tinte, claque. Sa mère distribue ses mouvements gratuitement. L’immobilité est un mal. Le silence, une infortune.
Elle sent sa tête descendre d’elle-même vers la table, prête à prendre le coup de coude qui viendra inévitablement lui mêler les idées.
Elle a essayé longtemps, mais des années d’expérience lui ont appris que sa mère parle pour sa propre intensité et non pour interagir avec ses proches. Elle se nourrit elle-même, mais demande toujours des autres. Insatiable. Une parole qui n’entend pas.
Elle se crispe. Elle doit demander douze dollars pour une sortie d’école. Elle repousse le moment depuis des jours.
Elle peut déjà l’entendre… Elle parlera de principes, de l’argent qui quitte son portefeuille avant même d’y entrer. De l’argent comme un concept « dont elle doit se libérer ». De la vie qui coûte cher.
Sa mère parle pour envelopper, pour étouffer, pour exiger. Chaque conversation est une main qui s’agrippe et réclame la pitié, l’empathie — elle voudra que l’on comprenne que la vie n’a pas été facile avec elle, qu’on devrait lui donner douze dollars et non les demander. Elle voudra être entendue, touchée, flattée. Comme des griffes qui s’enfoncent une à une dans le cerveau pour y faire le portrait d’une vie qui lui doit tout.
Ou, peut-être… Peut-être que son sentiment d’entité moralisatrice sera assez fort pour laisser échapper douze dollars.
Elle se souvient de s’être demandé si la sortie d’école en valait vraiment la peine. Sa professeur imprimait toujours les annonces de sorties sur du papier rose. Leur vue suffisait à déclencher les cris de joie d’adolescentes et d’adolescents prêts à tout pour sortir de l’enceinte de l’école quelques heures de plus.
Encore aujourd’hui, la couleur rose lui fait l’effet d’un typhon qui lui déchire les entrailles.
Elle est partie un jour, laissant derrière elle une maison mouvante et une mère dont l’énergie menace d’exploser à tout moment. Une maison de repas qui arrivent dans des boîtes. D’émissions de télévision toujours trop fortes pour une matriarche incapable de ne pas entendre le son de sa voix. De courants d’air constants qui rendent l’immobilité impossible. D’une tranquillité jamais acquise.
Elle est partie pour ne jamais y revenir.
***
Dehors, l’orage fait trembler les fenêtres. Sa moiteur empreint la chambre du motel. Le cadran affiche 3 h 33.
***
Le troisième petit four est plus froid que les autres. Son glaçage sucré reste collé au palais assez longtemps pour libérer encore plus de cette vanille fraîche qui glisse dans les narines.
Sa grand-mère remplit de nouveau sa tasse de thé et s’excuse. Elle n’est jamais excusée.
Elle s’excuse de sa fille. De ne pas avoir été plus là pour sa petite fille, pour rediriger le typhon. Pour la prendre dans ses bras. L’étreindre. Lui montrer qu’on peut être aimée en silence. Sans demande. Que l’amour gratuit existe. Qu’il ne demande rien et donne tout.
Sa grand-mère s’arrête. Ses larmes brillent, une rivière au milieu du désert. Mais la petite fille qu’elle a connu n’est plus, chaque année se terminant comme une finalité sans cesse mouvante, jamais statique. La connaissance de l’autre est inévitablement temporaire.
Elle entend sa grand-mère prendre une grande respiration. Sa voix monte alors jusqu’au plafond et se répercute sur les murs. L’image qui se développe devant elle la prend par surprise. Sa grand-mère, une jeune femme de petite taille et replète à la tête hornée de boucles noires lourdes et lustrées. Son sourire crée les mêmes sillons, mais en superficie. Ses yeux bleus ont la même lueur douce et déterminée. L’homme à ses côtés est émacié, ses épaules lourdes entraînant tout le haut de son corps vers le bas. Son regard ne quitte jamais la femme. Quand elle bouge, il marche dans ses pas.
La voix de sa grand-mère s’adoucit.
C’était un homme doux. Un être dont la force intérieure ne transpercera jamais les frontières de l’âme. Son corps restera frêle, une passoire aux aléas de la vie, incapable de bloquer les attaques. Il aimait sans limites. Sa femme, sa fille. En silence, de toute voix, en murmurant. « I love you. » Il vivait penché pour rester à leur hauteur. Il donnait sans demander. « I love you. » Toujours en anglais. Le « you » inclusif. Le « you » qui dit « toi » ou « vous ». Elle et toi. Vous deux. « You. »
Sa grand-mère s’arrête. Elle replace le coussin à côté d’elle.
Il aimait sa fille dans son infinité. Il restait auprès d’elle des heures durant, l’écoutant comme on s’abreuve à une fontaine d’eau fraîche jusqu’à ce qu’elle s’arrête, gavée d’attention. Elle marchait alors les jambes lourdes comme une reine après un buffet. Le typhon se calmait.
Sa mère, elle, rêvait d’un commerce bien à elle. Un endroit où se cacher de son monde et s’ouvrir au reste. Un endroit qu’elle pourrait contrôler. Un rêve entre quatre murs.
Elle partait à cinq heures le matin et revenait tard. Après souper. Sa fille l’attendait dans son lit, gavée d’attention paternelle, mais avide de l’amour maternel. Elle commence alors à demander plus, toujours plus. Mais la tête de la famille était ailleurs, entre les commandes en attente et l’horaire de la semaine à terminer.
L’enfant demande, exige, s’agrippe à une mère toujours plus fuyante, qui ne respire que lorsque la porte de la maison se referme derrière elle.
Le typhon devient alors de plus en plus difficile à tenir. Il bouscule, crie, réclame. Même son père peine à la calmer.
« J’aurais dû catcher que ma famille, pis ma p’tite, avaient besoin de moi. Mais moi, j’avais besoin de ma liberté. J’avais besoin de réussir, “to make it”. J’avais besoin d’être plus qu’une mère pis une femme. »
Sa grand-mère s’arrête. Les larmes continuent de couler, laissant derrière elles des traces de sel brillantes.
Elles auront perdu un mari et un père l’année suivante. Pour l’une, ce fut la fin d’une histoire d’amour, de la présence constante d’un allié. Mais pour l’autre ? Ce sera le début d’une vie de demandes jamais remplies, d’un trou qui se creuse lui-même.
La solitude est une foule hurlante.
***
Les petits fours sont froids. Le thé aussi.
Le glaçage a laissé un film huileux sur sa langue. Sa grand-mère regarde dans le passé.
« J’me suis jamais pardonnée, tu sais. J’aurais dû… quand y’est mort… tu comprends ? J’aurais dû fermer le commerce. »
Elle ne pleure plus.
***
La fatigue descend le long de sa colonne. Ses yeux se ferment. Sous elle, le sofa prend maintenant la forme d’un lit. Elle est directement sur le duvet qui sent l’orage et le parfum musqué qui s’amasse à la base du cou des hommes endormis.
La pièce est silencieuse. Elle devrait dormir. Mais la voix de sa grand-mère continue de la suivre comme un nuage. Il entoure sa tête, s’infiltre dans ses pensées.
Elle ouvre un œil et l’autre. Sa langue se décolle de ses dents, libérant le goût écœurant de sa propre haleine sucrée. Elle se tourne sur le dos. Le plafond est parsemé de taches sombres. Elle sent une présence. Son regard se pose sur les objets autour d’elle et s’arrête dans un coin de la chambre.
« C’est-tu juste moé ou ben les maudites activités d’école coûtaient toujours douze piasses ? »
Le typhon est là.
Juste à côté, le cadran affiche 4 h 44.
***
La réalité est un concept flou, incontrôlable — un point convergent entre un moment et une histoire sur le point d’être racontée. C’est une femme d’affaires ambitieuse qui mettra sur pied un commerce florissant alors que sa fille mangera le monde à grande bouchée sans jamais remplir son estomac grondant. C’est elle aussi, une femme si légère que personne n’a jamais vu sa trace. Une femme dont le cri ne résonne qu’à l’oreille des gens incapables de l’entendre. C’est une femme d’ambition. C’est une femme typhon. C’est une femme de silence.
Autour d’elle, la chambre du motel s’effrite. D’immenses craques sont apparues sur les murs et s’étendent maintenant au plafond. La peinture tombe en petits flocons jaunis. Son visage en est garni, mais elle n’ose pas bouger. Chaque mouvement du typhon envoie l’air voler en bourrasques.
Elle n’a jamais su comment on apaise un typhon.
« Je t’aime » s’enfonce et rebondit contre les murs, se retournant contre elle parce que l’amour est toujours endetté. Il doit quelque chose à quelqu’un.
« Si tu m’aimais vraiment tu… »
Les mots qui sortent de la bouche de sa mère déferlent comme une grande marée et frappe tout ce qui se trouve en travers de leur chemin. Il n’y a pas de refuge. Ils frappent, martèlent et transpercent pour aller s’installer au chaud dans le creux de l’estomac qu’ils torturent ensuite. Ils ne se laissent pas oublier, s’emparent de tout dans une malepeur du silence.
« Mom, je suis déso… »
Un moment de silence. Une demi-seconde. Avant le hurlement. La colère est noire. Une nappe d’huile. Elle coule et suffoque.
Elle comprend à ce moment-là que sa mère traîne un deuil cruel, qu’elle demande aux vivants de remplir le trou infini laissé par les morts — celui de l’amour qu’on doit à un père et de la vengeance que l’on réserve à une mère. Mais le deuil est une bien drôle de chose, une bête insatiable qui demande à jamais quelque chose d’impossible.
Elle se relève lentement, le lit résistant à ses efforts. Les couvertures l’empêchent de bouger. Elle se sent lourde, engourdie. Lentement, elle se relève pour venir se placer devant le typhon.
Leurs regards se croisent.
Elle ne sait plus la dernière fois qu’elle a regardé sa mère dans les yeux. Quand on évite le regard, on évite de voir l’autre, mais aussi d’être vue. La chambre tremble.
Et soudainement le silence. Comme si le monde s’était doucement replié sur lui-même. Devant elle, sa mère est menue, maigre. Elle se tient droite, fière, un sourire mauvais aux lèvres. Mais le masque ne tient plus. Des larmes chaudes et torrentielles s’écoulent et tombent au sol.
« On dirait j’suis juste quèque chose qu’on drop, là. Même moé, j’me voulais pus. »
Même moé, j’me voulais pus.
***
Au début, personne n’avait pu la joindre. Ce n’est que deux semaines plus tard qu’un policier exaspéré lui avait appris la nouvelle.
Sa mère avait libéré le cri ultime. Un typhon qui aura entraîné avec lui tout un bloc, un brasier attisé par la colère, une vengeance qui se termine dans les cendres. Sa mère avait eu la bonté de partir sans rien laisser derrière elle d’autre qu’une souffrance qui ne lui appartenait plus.
Elle revient à la chambre d’hôtel. Devant elle, sa mère se met à danser, comme un pantin dont les fils se sont emmêlés. Elle tournoie, s’accroupit, se lève et étire les bras au ciel.
« Tu danses pas mon pti loup ? »
Oui, mom.
Elle la prend délicatement par les mains, la fait tournoyer d’un côté et de l’autre. Des flocons d’un blanc immaculé tombent du plafond.
Sa mère se lance contre elle et enserre sa tête de ses deux bras. Contre son oreille, le souffle est chaud et il sent les cannes de Noël.
« I love you. »
***
Sa mère a dansé jusqu’au lever du jour. À la première lueur de l’aube, elle ouvrira la porte pour s’élancer à l’extérieur, ses pieds nus frappant le bitume. Alors qu’elle s’éloigne, sa voix claire rappelle le beurre sur une tranche de pain frais qui glisse entre les doigts et le long du gosier pour s’installer confortablement dans le fond du ventre. Elle chante.
I’m so lonesome I could cry
I’ve never seen a night so long
When time goes crawling by
The moon just went behind the clouds
To hide its face and cry
Did you ever see a robin weep
When leaves begin to die ?
Like me, he’s lost the will to live
I’m so lonesome I could cry
The silence of a falling star
Lights up a purple sky
And as I wonder where you are
I’m so lonesome I could cry[1]
I’ve never seen a night so long.
Le cadran est éteint.
***
Sa grand-mère est de retour. Elle porte une robe d’été, ses cheveux noirs ramassés dans un chignon lâche.
« Toé pis moé, on a écrit notre nom dans la poussière des erreurs, jusqu’à le graver dan’ roche. Mais y’a personne pour le lire. »
L’envie lui prend soudainement de sortir dehors, de respirer l’air pur, de sentir le soleil sur sa peau. De se secouer assez fort pour faire tomber la poussière, de courir assez loin pour laisser les morts derrière.
« C’est l’temps de laisser les fantômes s’reposer fille. »
Elle sait que ça ne sera pas facile. Elle se sent encore légère, prête à perdre pied à tout moment. Mais devant elle, le typhon a laissé un passage ouvert, silencieux.
Elle empoigne son sac d’une main et de l’autre ouvre la porte avec détermination. Elle sent la présence d’inconnus autour d’elle, une odeur de peur, de détermination, de résignation. Elle met le pied dehors et entend la porte se refermer derrière elle. Et c’est là qu’elle la voit : la pancarte du Motel est maintenant en anglais.
Elle sourit. Elle a peur. Mais c’est une peur qui électrifie, qui lui lui donne envie de sauter pour toucher le soleil. Elle sourit.
The silence of a falling star.
[1] I’m So Lonesome I Could Cry, B. J. Thomas ‧ 1973
AYCHA FLEURY.
Texte publié dans le No 44. Motel 666