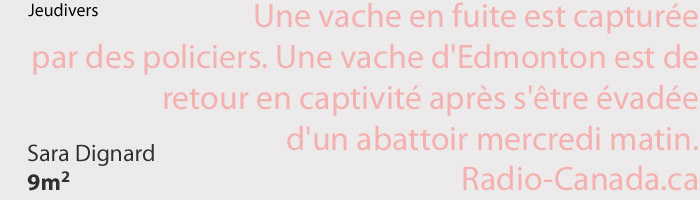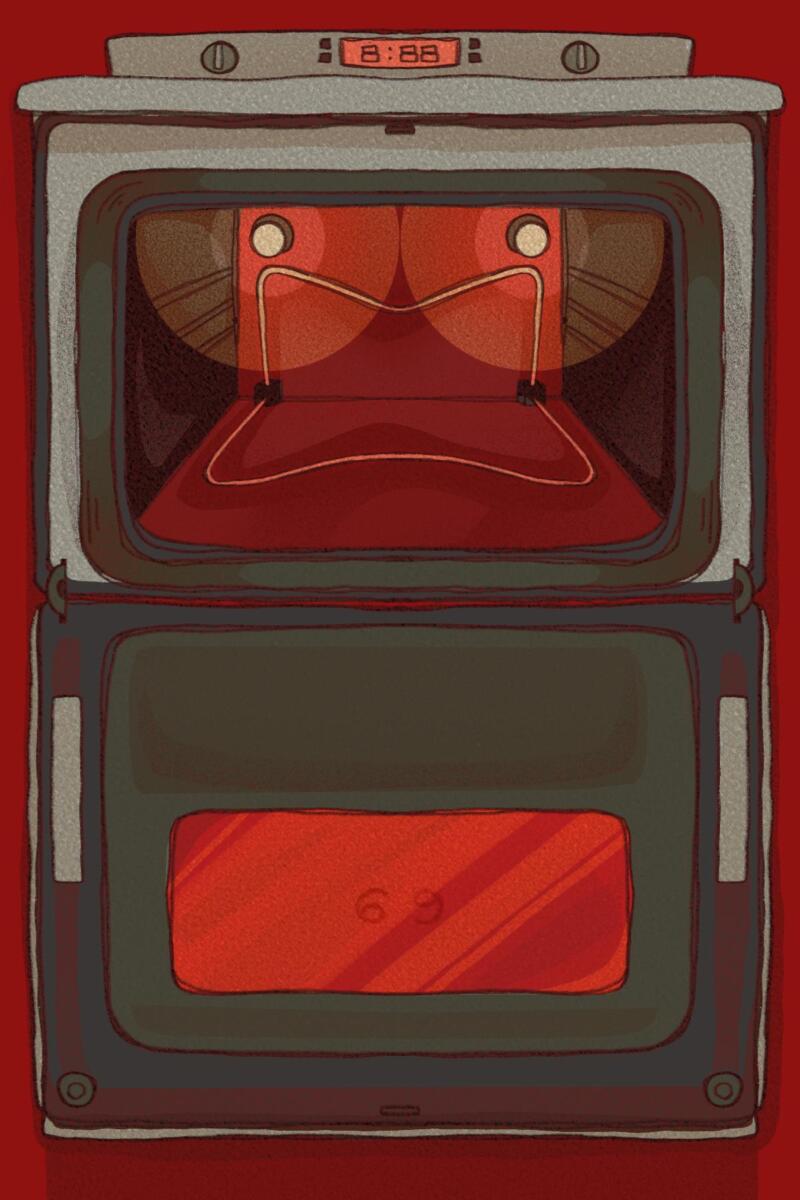
Daphné Geneau (2025)
À la réception du Motel Colonel, je me soumets au protocole d’admission ; je change mes souliers et bande mes yeux d’un long fil de réglisse verte. Dans la chambre 69, on ne peut porter que des souliers translucides à talon effilé. J’ai l’habitude. J’adore la solennité de ce motel de bord de route. Seule dans ma chambre, sur un tapis qui rêve d’être un parquet, je balade mes escarpins d’une démarche sensuelle. Théâtrale, j’accentue mon déhanchement pour charmer le silence. J’aime jouir de tout, je n’attends pas qu’on me frotte.
À 3h33, on cogne à la porte. J’ignore la requête et me roule dans l’édredon. Le tissu est rêche. Le contact irritant.
À 4h44, on cogne de nouveau. J’accepte. Les mains coincées entre les jambes, une servante m’escorte pas à pas. Au motel, il est interdit de se promener librement. Je sais que d’hideux secrets se campent derrière chaque porte close. Je préfère les imaginer que les rencontrer : des chambres de torture, une mezzanine submergée d’eau où nage une colonie de dauphins forcés d’apprendre le latin. Ou encore, au sous-sol, un théâtre de marionnettes où chaque scène de l’existence, depuis le début d’avant même le commencement, est jouée et rejouée en abîme de son passé. Je laisse couler à flots mes fantasmes et je rêve d’hémoglobine caressant les murs. La bouche entre ouverte, je frissonne d’excitation. Et de terreur.
Posant sa main sur mon épaule, la servante met un terme à mes fabulations. D’un geste impératif, elle désigne un tablier de papier bulle. Un sourire en coin, sans poser de question, j’y enfile mes bras nus. L’emballage plastique frôle mes membres, déclenchant l’éruption volcanique de mes souvenirs. Le tablier de plastique ne couvre que l’avant de mon corps. Nu. Le contact sur ma peau est à la fois frais et lisse, telle une feuille recouverte de rosée. Mon costume en place, le cœur battant comme une actrice s’apprêtant à monter sur les planches, on me dirige vers un évier vide. Poulette aux aguets, je me niche sur le rebord. La servante se retire, me laissant seule au milieu d’une cuisine immaculée. J’en profite pour coller une moustache de poils de bison sur ma lèvre. Talons aiguilles, tablier de bulles et moustache drue. Je me sens puissante.
Un bruit métallique fait vibrer le plancher. Il annonce l’arrivée du Colonel. Une force historique se dégage de l’homme. C’est un privilège d’être invité en sa demeure. Une odeur antique enveloppe le maitre. Comme s’il portait sur ses épaules, la couverture des parfums d’autrefois. Ce n’est pas déplaisant ; un souffle de sphaigne poivrée qui me raconte une histoire.
Je me tourne vers lui et incline le torse.
– Mademoiselle, merci de bien vouloir procéder.
Sa voix est rocailleuse, comme sur le point de s’ébrécher. Il économise sa parole. Le décompte est lancé, il a un sablier dans la gorge. Chaque parole dépensée diminue ses réserves. C’est un privilège qu’il m’adresse un « mademoiselle » ici et là.
Je ne comprends pas le contexte, le besoin, la trame, mais j’accepte tout, sur la pointe des pieds. Suis-je la première, la dixième, la centième d’une lignée de mademoiselles assignées à cette cuisine ? Seule mon imagination m’offre des réponses. J’ai compris que les questions sont proscrites au Motel du Colonel.
Devant lui, je suis légèreté, soucieuse de ne pas provoquer son effondrement.
Lors de ma première visite, j’avais remarqué que les yeux du Colonel refusent de voir. Le Motel loge une servante muette et un maître aveugle. Je m’y sens bien. Et presque utile.
Un voile ambré recouvre ses yeux, ce qui m’a amenée à le baptiser Colonel Moutarde. Son regard semble fixé vers le ciel. Peut-être qu’il essaie de capter un reflet de lune. Peut-être qu’il cherche une étoile du passé. Ou alors une échappatoire.
Aucune jambe ne meuble le bas de son pantalon de velours côtelé brun. Aucune chaussure ne prétend recouvrir ses pieds qui n’existent plus. Je suppose que le Colonel Moutarde est un héros de guerre, que ses jambes ont volé en éclats alors qu’il traversait un champ de mines pour sauver un ami. Ou un ennemi.
Ou peut-être que ses jambes l’ont déserté alors qu’amoureux éperdu, il a sauté d’une fenêtre pour échapper aux représailles d’une famille aigrie. Ou encore, aux prises avec d’inguérissables engelures occasionnées lors d’une mission scientifique visant à protéger le loup arctique, un collègue a dû procéder à l’amputation de ses membres brûlés par le froid. Sous mon regard, les jambes et le regard du Colonel se défilent.
Âgé, estropié, non-voyant, le Colonel a pourtant une pivoine dans son âme. C’est ce que j’apprécie le plus de lui ; cette stature droite qui semble dire : « après avoir traversé tous ces merdiers, mieux vaut se délecter des joies qui nous restent ». Cette résilience, cette capacité au plaisir, m’inspire.
– Veuillez débuter, mademoiselle.
Je me mets au travail. Penchée vers l’évier reluisant, mon derrière nu cambré, je m’efforce de souiller l’espace. Je recouvre les assiettes, les tasses, les fourchettes, de moutarde, de foie de canard, de gruau.
– Décrivez, mademoiselle, décrivez.
À la demande du Colonel, je narre chacun de mes gestes.
– Avec mon index et mon majeur, je trace des serpentins de confit d’oignon au creux d’un bol de faïence bleue.
– Soyez précise, mademoiselle, exige-t-il.
– Mes bras sont enduits de nourriture jusqu’aux coudes ; fond de bœuf, bouillabaisse, salade d’œufs. Les couleurs sont indiscernables, les textures se confondent. De la main droite, j’empoigne un vase de cristal. Mes empreintes tracent un chemin boueux sur le verre délicat. Mon bras gauche glisse autour du pot, le recouvrant d’une huile brunâtre. Puis, mon poing s’insère dans le goulot, faisant gicler la sauce sur le parquet.
– Très bien, cautionne la voix posée du Colonel.
– De mes deux mains avides, j’empoigne des avocats et des mangues infestés d’asticots grouillants. Par la pression de mes doigts, je fais exploser les fruits. Leur jus recouvre les armoires, dégoulinant sur le comptoir, jusqu’à rejoindre la boue sur le plancher.
– Poursuivez, me pris le maitre.
J’ai entendu dire que lorsqu’on perd un sens, les autres s’en trouvent décuplés en capacité. L’impact des odeurs et des mots sont certainement fort développés chez le Colonel.
– J’empoigne langoureusement des fraises dont la pulpe est gorgée de chaleur. Leurs minuscules pépins ¾ un souvenir en braille. Un à un, le rouge des fruits coulisse sur mon tablier, glissant jusqu’à l’aiguille de mes talons. Tétines de jeune fille en fleur, elles explosent sous le poids de mes souliers, en relâchant un soupir sucré. Des fragrances de bonbon dégoulinent sur mes jambes, faisant halte à la racine de chacun des poils, pour freiner leur chute…
– Pas les jambes, mademoiselle. Jamais, m’arrête le Colonel.
– Pardon.
Je rougis. Pourtant, je sais que le Colonel déteste parler de ses jambes, ces traitres qui l’ont déserté. Mordant ma lèvre inférieure, je me concentre et poursuis.
– À l’aide de pâtes fraîches, je ligote mes poignets derrière mon dos.
Je souris à l’idée d’inclure une touche de shibari dans ma performance. Depuis que j’ai découvert cet art érotique inspiré d’une technique japonaise, qui consiste à attacher des prisonniers, je me plais à voir mes mouvements restreints par la corde. Enthousiaste à l’idée d’éblouir le Colonel, je reprends.
– Inclinant mon buste vers la pile de vaisselle engluée, mes lèvres happent des cuisses de grenouille congelées. Un à un, je mastique les batraciens glacés, croquants. Leur rigidité électrise mes gencives, dessinant un réseau de frissons sur ma peau. Je recrache les morceaux dans un bol de porcelaine. La soupe visqueuse déborde. Une odeur marécageuse danse.
Essoufflée par ce récit orgiaque, à 8h88, je prends un moment pour souffler. Je réajuste mon corset de bulles. La température boréale du Motel pince mon derrière.
Pour me réchauffer, j’allume le four au fond de la cuisine.
Mes mains, poisseuses d’avoir souillé, se fraient un chemin vers mes cheveux. Mes doigts s’y glissent comme des vers de terre sous la pluie. Une pâte visqueuse dégouline sur ma poitrine, mon cou, mes paupières et mes espoirs. Je frémis.
Mon ventre abrite une envie torride.
La porte du four grande ouverte, je m’approche à reculons. Mon cul mouillé accueille la chaleur avec jouissance.
Au fond du four clignote un néon ambré : Colonel Mustard.
Je m’enfourne pour cuire la plus exquise des brioches.
JOËLLE BOILY.
Texte publié dans le No 44. Motel 666