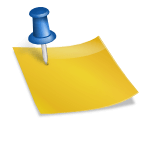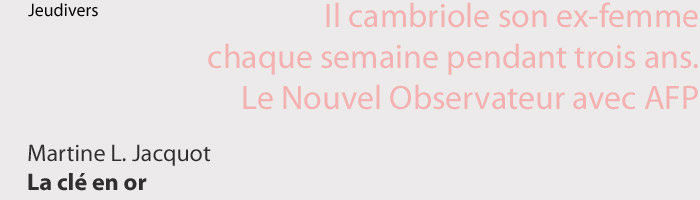I. Ruissellement
C’était le même cauchemar depuis des années. Son char descend le chemin désert, les maisons qui l’allongent sont vides, plusieurs manquent de portes comme des pauvres bougres qui manquent de dents, dévoilant un espace inhabité. Une antenne parabolique titanesque qui autrefois captait un signal céleste à présent pointait son nez vers la terre. Un El Camino blanc et rouillé sans pneus et sans capot est posé sur des parpaings, le reste de son moteur dépouillé exposé aux éléments. Les chaînes d’une galance d’enfant pendouillent avec le siège cassé en deux au bout et émettent un léger grincement. Des bateaux en coque d’aluminium attendent patiemment sur leur remorque que personne ne viendra atteler pour aller à la pêche. Certaines fenêtres sont ouvertes, certaines brisées, des rideaux battent dans le vent à travers les vitres cassées ; pas de bateaux de chevrettes qui flottent dans le bayou, mais quatre ou cinq sont à moitié calés, leurs paupières tordues, les filets déchirés, toujours amarrés aux embarcadères en ruine. Leurs noms et numéros d’immatriculation sont effacés, délavés, radiés, indéchiffrables ; quelques lambeaux de fanions en plastiques rouges, blancs et bleus battent dans le vent au-dessus la poupe, souvenirs d’une bénédiction de la flotte qui n’a pas prise. Un silence calfeutré absorbe même le bruit des pneus sur le goudron. Le bourdonnement du sang qui circulait dans ses oreilles servait de bande sonore à ce film d’horreur, le même vagissement sourd qui l’enveloppait quand il était plongé sous l’eau.
On pouvait s’attendre à ce que des zombies se présentent sur son chemin, mais il demeura seul comme un chien dégradé. Il arriva jusqu’en bas du village, après le panneau marquant sa limite territoriale et vous souhaitant un retour rapide. Il monta la petite levée, une sorte de gendarme couché glorifié à vrai dire, un monticule ridicule qui essaie de faire face aux eaux du golfe. Il s’arrête en haut. Il ouvre la portière et sort pour surveiller la scène. À sa gauche, les écluses sont ouvertes, laissant passer l’eau, lasses d’essayer d’éviter l’inévitable. Devant lui, il voit le chemin plonger sous l’eau. À travers les vaguelettes qui perçaient la surface de l’eau, il voit le marquage du chemin disparaître petit à petit. Là où il y avait des maisons et des mobile-homes, il ne voit plus que des charpentes. Des cimes d’arbres comme des îles flottantes vertes dans une mer de chocolat au lait. Il lève les yeux et au lieu de voir le bayou continuer vers le golfe avec les herbes verdoyantes des marécages, il voit le golfe. Le Golfe du Mexique, comme un intrus, surgit de nulle part. Elle est déjà là, devant lui. De l’eau, partout, comme si elle avait toujours été là. Ses yeux cherchent l’horizon, mais ne le trouvent pas, faute de points de repère et manquant la force nécessaire pour aller plus loin. L’odeur d’eau saumâtre et de boue pourrie ne laisse aucun doute. Toute cette côte, toutes ses vies, les églises, les cimetières, les villages de pêcheurs, les camps, les quais, les arbres, les magasins, les marinas, les stations-service, tout ça gone, gone, gone, mangés, avalés, engloutis par l’eau salée. Et brailler va jamais la ramener. Pour un peu, il verrait sauter quelques marsouins, mais aucun signe de vie ne se présente, même pas de pélicans qui planent en formation précise les uns derrière les autres. L’eau et le ciel sont de la même couleur. C’est tout. Mais cette fois-ci, à ce moment précis dans ce cauchemar, au lieu de se redresser comme d’habitude en sursaut dans son lit en aspirant un grand coup d’oxygène comme dans une crise d’asthme, il rentre dans la voiture, serre le volant, respire profondément et appuie sur l’accélérateur. L’éclaboussement de l’eau est le dernier son qu’il entend.
Il se réveille en douceur en battant ses paupières comme s’il s’était assoupi quelques instants pendant la lecture d’un passage ennuyeux d’un livre sans intérêt. Il est surpris de se retrouver baigné dans sa propre sueur, ses draps et le matelas mouillés. La chaleur a ouvert les robinets de ses pores, transformant son lit en milieu uligineux. Son propre relent musqué lui montait au nez. Il se lève tout nu et traverse la cuisine pour chercher un verre d’eau fraîche, la sueur dégoulinant le long de son dos jusque dans la raie des fesses. Il pousse le verre contre le levier dans la porte du frigo, activant un jet d’eau et allumant une petite ampoule bleutée. Le mot anglais « slake » se présente spontanément à son esprit en sentant la descente du liquide dans sa gorge. « Étancher » peut-être ? Proche, mais « slake » ne comporte pas le sens d’« imperméable ». Encore un espace vide. L’apaisement de sa soif envoie un frisson à travers son corps. En regardant par la fenêtre, il voit les premières lueurs d’une journée qui s’annonce lourde et orageuse ; l’odeur de la pluie est pourtant absente. Le ciel est jaune. L’air est chargé d’une énergie kinésique comme si une main tenait les branches des arbres tendus en arrière, prêtes à fouetter en avant dès qu’elle les lâche. Le vent est chaud et sec comme une étincelle prête à enflammer le monde entier. Il contemple le contraste entre le sec et le trempé, le feu et l’eau, le jour et la nuit, comme le yin et le yang tatoués entre le pouce et l’index de sa main gauche. Plus à l’est, sans qu’il le sache, les eaux du raz-de-marée poussé par la tempête s’infiltraient déjà en-dessous les levées de la ville, préparant leur effondrement imminent.
Il regarde l’heure sur la vieille horloge qu’il avait héritée de sa grand-mère. La forme rappelle celle du bicorne de Napoléon. Il l’avait toujours détestée à cause de ses carillons qui sonnaient tous les quarts d’heures, l’empêchant de dormir, le gardant dans cet espace entre le rêve et l’éveil où son esprit divaguait. Une de ses plus grandes joies était quand il a arraché les petits marteaux qui frappaient les lames métalliques à l’intérieur. Son silence rend le passage du temps supportable et garde la bonne distance entre l’au-delà et l’en-deçà. À côté sur la même étagère, le portrait d’Évangéline, une image au fait de la statue de Dolores del Rio qu’on trouve derrière l’église de Saint-Martin de Tours, était peinte sur une assiette qu’il a héritée de sa mère. « Sacré héritage”, a-t-il pensé. “Napoléon et Évangéline. Un dictateur qui nous a vendus aux Américains et une femme fictive créée par un Yankee. »
C’est trop tôt pour s’habiller et sortir. Le ciel jaunâtre vire plus vers le rose et puis des lueurs bleues se pointent malgré les nuages menaçants au loin juste au moment où le soleil perce l’horizon derrière les maisons de l’autre côté du bayou. Il s’essuie le visage et le corps avec une serviette en papier, enfile quand même un caleçon, car il voit que les voisins commencent à allumer leurs cuisines aussi. Les maisons sont les unes sur les autres dans ce voisinage qui s’est développé autour de lui depuis quelques années, ne laissant pas beaucoup de « privacy », un autre mot qu’il a du mal à traduire. Privé, mais privé de quoi ? Il hausse les épaules et met la grègue Mr. Coffee en marche avant de retourner à sa traduction de Macbeth.
Acte I, Scène I. Une place déserte
Tonnerre et éclair. Entrent trois Sorcières
Première sorcière
« Équand les trois de nous-autres va se voir encore
Avec le tonnerre, l’éclair et la pluie dehors ? »
Deuxième sorcière
« Équand le charivari est arrêté,
Équand la bataille est perdue et gagnée. »
Troisième sorcière
« Ça va d’être avant le coucher de soleil »
Première sorcière
« Éyoù la place ? »
Deuxième sorcière
« Dessus la prairie. »
Troisième sorcière
« Là pour joindre Macbeth »
Première sorcière
« Ej viens, minou gris. »
Deuxième sorcière
« Crapaud appelle. »
Troisième sorcière
« Talheure. »
TOUTES
« Le vaillant est couillon et le couillon est vaillant :
Allons guetter dans le brouillard et l’air pourri. »
Il lisait et relisait cette dernière ligne. Il cherchait la rime, mais ne la trouvait pas. « Fair is foul and foul is fair. » Ça va, ce qui est juste est injuste aussi, il pense. Le vaillant et le couillon, c’est deux choses différentes qui ne vont pas ensemble. Il se demande si Orwell ne pensait pas aux trois sœurs bizarres quand il a écrit « La guerre, c’est la paix ». Mais plus tard, quand Macbeth rentre sur la scène, est-ce qu’il faut dire, « Un jour si couillon et vaillant que je n’ai pas vu » ? Non, peut-être « Un jour si pourri et beau que je n’ai pas vu » ? À ce moment-là, ce n’est pas exactement une rime quand on dit : « Le pourri est beau et le beau est pourri / Allons guetter dans le brouillard et l’air pourri. »
Il réfléchit un peu plus sur la traduction. Les mots voltigent dans sa tête comme les grains de pissenlits soufflés par le vent. « Hover in the fog and the filthy air. » Il était particulièrement fier d’avoir trouvé « Allons guetter » comme traduction, donnant le sens de rester aux aguets des événements qui allaient suivre. « Filthy », en revanche, n’était pas tout à fait pourri. « Sali » peut-être pour faire la rime avec pourri qui déménagerait en haut ?
TOUTES
« Le pourri est beau et le beau est pourri :
Allons guetter dans le brouillard et l’air sali. »
Il contemple cette tournure quelques instants. La grègue gargouillait pour signaler que le café est paré. Il regrette d’éliminer « vaillant » et « couillon ». Ça donne une couleur plus louisianaise à la phrase, tout comme ce qui précède. Tant pire, il pense, je trouve la deuxième solution plus élégante, et « sali » est plus proche de dégueulasse, le mot que j’aurais utilisé si je faisais une traduction en français contemporain. Le mot dégueulasse lui rappelait la fois que son père l’avait poigné après jouer sous la maison. Il en est sorti couvert de boue. Il ne comprenait pas ce qu’il lui avait dit ce jour-là, car il ne parlait pas un mot de français, mais ses propos sont restés enfouis au fond de sa mémoire jusqu’au jour où il a pu les décoder : « Espèce de souillon ! »
« Souillon, » c’est ça.
TOUTES
« Le couillon est vaillant et le vaillant est couillon :
Allons guetter dans le brouillard et l’air souillon. »
Il décide de le laisser comme ça pour l’instant, tant pire pour « Un jour si pourri et beau que je n’ai pas vu. » « Un jour si souillon et vaillant que je n’ai pas vu » devait faire l’affaire. Il s’arrête là, satisfait du début de sa traduction. À vrai dire, c’est plutôt une adaptation. Le premier jet était dû dans trois semaines pour le début des répétitions. Il ne se rappelle pas les circonstances, mais il s’était engagé d’écrire une version « cadienne » de Macbeth. Peut-être parce que l’espoir de passer du temps avec Sabrina lui paraissait enfin possible. De toute façon, le café est chaud et il en avait besoin pour avoir la force d’aller s’habiller et affronter cette journée qui s’annonce malséante.
Il écarte les tasses sur le devant de l’étagère avec « Laissez les bons temps rouler », « Tabasco » et « Eat Oysters, Love Longer » écrits dessus pour trouver celle qu’il préfère, celle qui donne un goût spécial. C’est une tasse un peu croche, comme si le vent la poussait d’un côté avec « Chicago » inscrit à l’extérieur et « The Windy City » à l’intérieur. Il l’avait achetée à l’aéroport O’Hare quand il est revenu de France pour s’installer de nouveau aux États-Unis. Il verse le café. Il repose la grègue, attrape la tasse avec les deux mains et regarde la noirceur profondément comme s’il essayait de lire la bonne aventure dans le marc à café. Il porte la tasse doucement à ses lèvres, inhalant l’arôme, humant le liquide avec un clappement de la langue en signe de capitulation au plaisir de boire cet élixir divin. « Double, double, travail et trouble/Le feu brûle et la chaudière bouillonne ».
— Je vais trouver une rime plus tard, pense-t-il. Je dois m’occuper de mon fils.
— Il serait temps que tu penses à lui, lui dit Évangéline. Tu perds ton temps sur ce projet ridicule. Qui veut écouter une version « cadienne » de Shakespeare ? Qu’est-ce que tu comptes accomplir à part te faire remarquer par cette femme qui ne veut que se servir de toi ? Tu étais beaucoup mieux avec Sherrie. Au moins, elle, elle sait faire un roux.
Évangéline tourne sa tête en haut et en arrière pour détourner son regard, lui donnant un petit air de l’Évangéline de Grand Pré. Reculant son fauteuil de sa table de travail, il ferme son laptop et se dirige vers la chambre à bain pour prendre une bonne douche froide. Évangéline retrouve son aspect souffre-douleur et docile, telle que Longfellow l’avait décrite comme une femme parée à attendre passivement l’amour de sa vie en bas d’un chêne vert.
— Quel couillonade, pense-t-il.
II. Évaporation
Le pépiement des cardinaux ponctuait les palabres des nombreux oiseaux, – moqueurs, geais bleus, tourtes et moineaux, – qui se donnaient des nouvelles matinales. Les branches des pacaniers se chargeaient de chatons, ses bouquets inflorescentiels qui rendent la pacane, ce fruit sec, pas tout à fait une noix, qui contribue de façon spectaculaire au compte calorifique des desserts cadiens : tartes aux pacanes, pralines, fudge ou tout simplement nature. Malgré sa tendance à engraisser, elle est une excellente solution anti-oxydante. Un vent du sud chargé de chaleur sentait la pluie.
« C’est la fête à Ti-Huey aujourd’hui, » a pensé sa Mawmaw en rentrant le linge des clients du séchoir. Sa journée avait commencé avant le lever du jour. « Et ça fait trois ans que je l’ai pas vu. » Ce jour-là, il avait soudainement disparu avec son père et la Cadillac. Ils avaient laissé derrière eux mère et femme, deux étrangères devenues partenaires dans l’hôtellerie, un « café-couette » offrant gîte et couvert garanti 100 % cadien aux touristes, les tout tristes comme elle les appelait, en quête de nouvelles expériences désennuyantes.
Au début, ça faisait mal comme une jambe atteinte d’une gangrène. Très vite, on se fait à l’idée qu’il faut s’en séparer. Et ça n’empêche pas qu’on s’ennuie de son membre manquant. Mais entre la vie et la mort, le choix est vite fait.
« Sherry ! Est-ce que tu peux venir voir une minute, s’il te plaît ?
« Ouais, Miss Edwina. »
Elle n’avait jamais compris ce qui aurait pu attirer son fils à cette Protestante du Texas. Trop pâle, trop maigre, trop petite, trop ceci, trop cela, trop… Américaine. Du temps qu’ils habitaient tous dans le même voisinage, il restait quelques beaux souvenirs, mais trop d’amertume au fond de la gorge remontait comme un brûlement d’estomac. C’était comme un bon gombo servi sur du riz pas assez cuit ou trop salé. On pouvait toujours le manger, mais à quoi bon ? Son fils était promis à un avenir si brillant. Il avait une bourse académique à la faculté de droit de Tulane. Il est allé le premier jour, il a écouté ce qu’ils avaient à dire et il n’y a plus jamais remis les pieds. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait tout garroché par-dessus la barrière pour les beaux yeux de cette Texane. « C’est vrai qu’ils sont beaux » a-t-elle pensé.
« Quoi ce qu’ej peux faire pour vous ? »
Elle avait quand même appris à parler français, quelque chose que son fils ne commençait à faire que quelque temps avant de disparaître. Elle se demande s’il ne devenait pas jaloux de sa femme qui parlait politique en français en bas du chêne à Caouanne avec Plute, Piche, Boudou et les autres. « Il est juste comme son père. Il veut juste ça qu’il peut pas avoir. »
En tout cas, c’était vers l’époque où Ti-Huey babillait ses premiers mots. « Maman, Papa, banane… » C’était cette même année que Mawmaw est allée à Medugorje, qu’elle avait ramené une petite statue de la Sainte Mère qu’un des enfants à qui elle parlait avait touchée. Elle regrette maintenant de l’avoir donnée à son fils ; elle était sûre de ne plus jamais la revoir.
« Sherry, t’avais pas attendu le téléphone faire du train hier au soir ? »
« C’était le téléphone sur le TV. Je pouvais pas dormir alors j’ai guetté les vieux shows. »
« C’était quel show ? »
« C’était, huh, un vieux Hercules avec Steve Reeves. »
« Y’avait pas de telephone dans Hercules. »
« Non, huh, c’était pendant les commercials. »
« Mais chère, je connais pas quofaire tu mets ta tête plein de fatras comme ça. T’as besoin de ton repos. »
Depuis quelques années, au fait depuis le décès accidentel de son mari et le départ de son fils, les affaires de Miss Edwina allaient très bien. C’est vrai qu’elle a reçu une grande somme d’argent des assurances qu’elle a utilisé pour acheter la vieille maison de M. Tutute et la convertir en café-couette. Mais si elle n’avait pas travaillé fort pour attirer les touristes et se plier à leurs quatre volontés, elle aurait gaspillé son investissement. Une maison vide ne paye pas les factures. Et les gens sont venus. Il semblait que le monde entier a découvert la musique et la cuisine cadiennes. Il voulait se rendre sur place pour faire l’expérience de « l’authentique. » Au « Kajun Motel », il a fallu que Miss Edwina rajoute du cayenne à toutes ses recettes pour faire l’authentique que les touristes recherchaient. « Si ma défunte mère me voyait avoir la main si lourde avec le poivre, elle aurait tout jeté aux cochons. Ej pense que même eux, ça voudrait pas le manger. »
Même Nonc Dud que tout le monde écoutait le matin à la radio KARF et le soir aux différents saloons du coin a été obligé d’ajouter un joueur d’accordéon à son groupe parce que le monde étranger ne croyait pas que c’était de la vraie musique cadienne sans ça. D’ailleurs, il ne disait pas cadien jusqu’à récemment. Pour lui, c’est de la musique française, comme il se disait français, les autres étant des Américains. Il a engagé un bougre de la Ville Platte qui prenait le bateau à la Grand’ Île pour aller travailler sur les plateformes. Il était tool-pusher pour Schlumberger. Quand il avait ses sept jours off, il jouait avec « Nonc Dud and his Half-fast Cajun Band » pas parce qu’il avait besoin d’argent, mais parce qu’il aimait jouer dans ces bars de l’autre bord du bassin. Son préféré était le Kit-Kat Club qui se trouvait à l’autre bord du chemin de l’hôtel à Miss Edwina. Il y avait toujours plein de touristes, souvent des jolies femmes du nord-est des États-Unis qui voulaient apprendre le two-step avec lui.
Ça faisait que Mme Edwina avait assez de l’ouvrage pour ne pas s’ennuyer d’une jambe coupée. Mais elle avait du mal à se tenir debout.
III. Condensation
À l’entrée de l’allée des chênes barbus, en retrait sur la gauche, un néon bleuâtre proclamait que la meilleure bière au monde était brassée avec l’eau du bayou. Naviguant sur la mousse de la Voie Lactée, une Cadillac autrefois jaune écume la nuit et ignore les faibles excuses sur le pitoyable état de la route, « Drive Carefully Substandard Highway ». Elle vogue comme un bateau à la dérive dans une mer vengeresse. Les langues de feu descendent sans discrétion, frappant le conducteur de plein fouet à travers le toit amovible. Bientôt, il commence à parler une langue dont seul Dieu le Père décèle la douceur.
Sa route est longue et lassante, mais il continue à rouler sur des vapeurs d’essence : son réservoir est quasiment vide, la jauge n’a jamais marché. Son cœur imite les battements de sa langue contre son palais somptueux, délectant l’amertume de sa chanson de réglisse. Le rétroviseur lui renvoie le trou béant de la nuit qui le rattrape au même rythme de sa fuite. La radio a capté une station hispanique évangélique. Il écoute de la musique. L’accordéon lui rappelle quelque chose, les voix stridentes lui rappellent quelqu’un.
Ensuite la radio envoie sur onde une discussion moitié en espagnol moitié en anglais avec traduction. L’hispanique prétend que puisque Jésus n’a eu que douze apôtres, un prédicateur ne pouvait pas avoir plus de douze disciples. Chacun de ses disciples ne pouvait pas avoir plus de douze adeptes et ainsi de suite. Le prêcheur américain, du sud profond à en juger par son accent, en ne voulant pas réduire la taille de son audience le dimanche matin, et donc les recettes de la quête certainement, balayait ces arguments en disant que le sacrifice de la Croix emportait sur tout. Plus grand le nombre de convertis qu’un prêcheur peut obtenir, plus grand sera sa récompense au Royaume de Dieu.
Le conducteur regarde par-dessus son épaule droite : l’enfant dort. Son regard revient sur le tableau de bord, attiré par la voix de la statue de Marie collée dessus. Elle était tout de bleu vêtue, les paumes des mains pressées plates au-dessous la poitrine, sa tête penchée vers la gauche, debout sur un demi-globe céleste ses pieds nus écrasant un serpent. Elle dit avec son accent du Moyen Orient, « Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre comme bêtises ! ». Elle gronde ensuite le conducteur d’avoir quitté le chemin des yeux, ne serait-ce qu’une ou deux secondes pour vérifier son trésor terrestre endormi sur la banquette arrière. Elle lui dit de s’occuper de ce que la route lui offre devant, le reste n’ayant pas beaucoup d’importance pour l’instant. Même son Fils ne peut pas changer le passé, modifier ce qu’on a laissé derrière pour toujours.
Les yeux devant, mais l’esprit retourne toujours en arrière.
Elle lui demande de fermer ce poste qui lui casse les oreilles. Le bruit pour le bruit, parler pour ne rien dire est néfaste pour la tranquillité de l’âme, dit-elle, surtout pour écouter des bêtises des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. « Que savent-ils de mon fils ? Ils ne l’ont jamais rencontré. » Mais s’il y a une chose que le conducteur abhorre plus que le chaos, c’est le silence assourdissant et brutal. Comme le silence qu’il a connu lors du passage de l’œil de l’ouragan Betsy en 1965. Ce silence était pire que le vent qui s’époumone, pire que la pluie qui tombe en déluge, pire que les débris qui s’épaillent, il y a le silence, le calme mort de l’œil. Ce halo bleu qui permet à Dieu d’y voir clair, de faire les comptes, de reconnaître les Siens, de reprendre souffle et de recommencer dans l’autre sens. Il préfère de loin le son et la furie, car il sait ce que ça signifie.
Il sait ce que peut faire cette haleine du Diable : accrocher des femmes par les cheveux aux branches d’arbre ; arracher des bébés des puissants bras des pêcheurs ; ou laisser tranquille une vieille bâtisse en bois pourri à côté d’un tas de drigaille qui était une maison de millionnaire. Dire que des gens voulaient faire la fête au lieu de prendre leurs jambes à leur cou. Ça n’a pas d’allure.
Le bruit, ça le connaît. Élevé par Lassie, Ed Sullivan, Gilligan’s Island, Hogan’s Heros, Twilight Zone et Star Trek et d’autres parents télévisés succédanés, il a besoin de ce fond sonore qui l’empêche d’aller au fond de lui-même. La télé qui marche toute la journée, ça ne lui fait pas peur. Bien au contraire, l’invention de la télécommande était le comble de l’extase.
Au lieu d’éteindre la radio comme demandé, il pèse sur la touche « Search ».
Un cowboy proclame son amour en peignant sur un château d’eau « I ♥ Betty Sue » dans le même ton de vert que les tracteurs John Deere ; une grande gueule mégalomane crie à se cracher les poumons que les Communistes, qui s’appellent le Nouvel Ordre Mondial à présent, conspirent toujours de dominer le monde ; deux ou trois chansons d’il y a une quinzaine d’années fraîchement reprises façon hip-hop ; encore un bon chrétien qui explique pourquoi c’est correct de fesser ses enfants tant qu’on le fait dans l’amour du Seigneur et pourquoi une femme doit se soumettre aux quatre volontés de son mari ; enfin, « If it keeps on rainin’, levee’s goin’ to break/ If it keeps on rainin’, levee’s goin’ to break/ When the levee breaks, I’ll have no place to stay. » Le conducteur ferme enfin le poste.
« Le silence rend fou peut-être, se dit-il, mais je suis pas rendu au bout encore. » Pour creuser l’écart un peu plus, il met une cassette de Tracy Chapman et la chair de poule lui picore le bras. « You got a fast car/ I want a ticket to anywhere. »
Ses phares renvoient un éclat blanchâtre. Un autre panneau le met en garde, en cas de temps froid, contre un verglas théorique qui se formerait sur le pont avant que la chaussée défoncée ne se gèle.
« L’état peut manquer d’argent pour les chemins, mais les politiciens ne manquent pas d’air, pense-t-il. Pour un pays qui voit la neige une fois tous les dix ans, c’est un peu exagéré, je trouve. D’ailleurs, ça doit être le cousin du gouverneur qui tient le contrat des panneaux. On devrait élire quelqu’un qui a un cousin avec une machine pour arranger les chemins. »
Marie lui conseille plutôt de s’occuper de sa parenté à lui.
« Je fais que ça, ma Mère, je fais que ça. »
La fatigue l’envahit comme une armée arrivée en pays conquis. Il sait où, un peu plus loin, gîte et couvert l’attendent, un vrai oreiller pour la tête de son enfant, pas un Levi 501 roulé serré en boudin. Il attrape son cellulaire et compose le 1-800-FOR-KJUN. Il quitte un chemin pour en emprunter un autre. Il n’est pas sûr de gagner dans l’échange.
Il passe devant des maisons basses en briques, style « Ranch » avec des pelouses infinies constellées de roues de charrette à moitié enterrées, des tracteurs en état avancé de mort par rouille et d’innombrables statues de Marie. Du tableau de Marie, elle fait de la tête un petit Bonjour à une de ses consœurs nichées dans une baignoire coupée en deux.
« Tu la connais ? »
« Oui, on a été à l’école ensemble. »
« Je ne savais pas qu’il y avait une école pour les vierges. »
« Malheureusement, il y en a de moins en moins. »
Il passe devant encore quelques maisons alignées le long du chemin avec accès sur le bayou derrière. Quand sa voiture arrive devant la dernière maison avant le pont, il s’arrête. Il coupe le contact et Marie se fige dans sa pose pieuse. Il ouvre la portière et laisse tomber son pied gauche dans sa botte en peau de cocodrie lourdement sur le chemin de coquillage. Il s’avance vers la maison en faisant un bruit de craquement. Il monte les escaliers en bois de cyprès en regardant les berceuses réservées aux invités pour la contemplation du bayou. Il y en a une qui semble se bercer toute seule dans la brise légère du petit matin.
Debout sur la galerie du « Kajun Motel », il scrute le ciel. À l’ouest, la lune est proche couchée après sa traversée nocturne ; à l’est, le soleil est sur le point de se lever. Il sort son mouchoir de poche, un bandana rouge à vrai dire, et s’essuie le front. Il fait chaud déjà. Il a l’impression de sentir du café et d’entendre une radio jouer de la musique cadienne à l’intérieur.
« Y a quèqu’un ? Ej peux erentrer ? »
Pas de réponse.
Il entre quand même et se fait immédiatement assaillir par l’immobile confusion des murs entièrement recouverts par des cartes de visites du monde entier. Une mémoire vivante, des archives intarissables.
Dehors, il entend l’enfant qui l’appelle par son prénom. « Je souhaite que cette badgeuleuse de Marie l’a pas réveillé. Sinon, elle va m’entendre celle-là. »
L’enfant sort de la voiture pour voir un chaoui entrer en se pressant dans le creux d’un chêne gris. Il ne connaît pas le mot chaoui, alors il appelle le raton-laveur « Bandit ».
« Soif, il dit, j’ai soif » et s’appuie contre la machine de Pepsi.
L’homme fouille dans la poche de son jeans et produit les six escalins que la machine requiert. « Ça c’est drôle, il me semble que ça coûtait une piastre la dernière fois, il y a si longtemps. » Il introduit les trois pièces de monnaie dans la machine. « Tu veux la même chose ? » demande-t-il inutilement. Il ne se retourne pas pour voir son enfant dire oui de la tête.
Il lui tend la bouteille de Barq’s Root Beer. L’enfant l’attrape et l’ouvre avec le décapsuleur cloué contre le mur. La capsule tombe dans une vieille boîte jaune de Golden Key Coffee avec tant d’autres. L’enfant boit goulûment, une rigole dégouline du coin des lèvres.
« Et où est-ce qu’on est rendu ? »
« Tu vas voir, mon petit, tu vas voir. »
L’homme implore Marie du regard ; elle préfère ne rien dire à l’enfant.
« Et alors ? » dit l’enfant
« Va chercher les valises, mais fais doucement, tu veux pas réveiller l’ours qui dort. »
« On est chez Smokey the Bear ? »
« Non, pire que ça. On est chez nous. »
Marie les regarde monter les escaliers et fonce les sourcils. « Il ne pense jamais à baisser une vitre. »
David Cheramie
Texte publié dans le 30e numéro Traces. Rencontre Nord-Sud