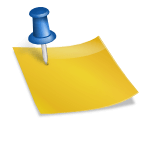Seymour est une rue en attente. Elle attend les livreurs du théâtre d’à côté. Elle attend les marcheurs qui cherchent Oak Lane. Elle attend les stationneurs venus se poser sans porter attention à la beauté de ses murs de briques. Et elle attend, en retenant son souffle, l’arrivée toujours discrète de ceux et celles qui connaissent le secret bien gardé, cette alcôve cachée dans ses entrailles, le cœur de la ville.
—-
La nuit prend forme par un souffle, un saoul et un pouf.
Jeanine avait été incapable de se débarrasser du gros coussin en velours doré qui l’accueillait à l’entrée depuis plus de 20 ans. Elle s’était convaincue que ses sentiments pour le velouté du meuble seraient partagés et l’avait donc placé délicatement au coin de la rue, persuadée qu’il vivrait une autre longue vie loin de la désolation contrôlée du théâtre. Mais la plus grande qualité du pouf, la nuit nous dira, est de pouvoir rouler jusqu’au centre de la rue Seymour, dans l’attente de l’homme saoul qui, soudainement désorienté par un coup de vent bien placé, finira par s’y écraser de tout son long.
Au loin, on entend le mascaret poursuivre sa course, sa deuxième de la journée. Mais le son de la vague est masqué par celle d’un souffle. Celui du garçon qui regarde le saoul. Il n’aime pas le noir, n’a jamais aimé le noir, et devant lui, le saoul est saoul et il est couvert de nuit. Il n’avait pas prévu de devoir gérer la présence d’un pouf. Encore moins celle d’un saoul. En fait, il n’avait même pas prévu la nuit et qu’elle puisse être aussi noire. Il n’avait pas prévu.
Il balaye la rue du regard. Seymour elle-même ne semblait pas s’attendre au saoul. Il ne livre rien, ne stationne rien et en plus il ne marche même plus. Il roule. Mais elle l’attendait lui. Le garçon. Celui qui s’éloigne de son ombre.
—–
Sur le bord de la fenêtre, une chandelle frétille contre le souffle de la nuit. « Farme cet’ fenêtre-cit’ t’as si peu’ du noir. » Mais il ne veut pas. S’il a peur du noir, il reconnaît encore plus le danger mortel de l’étouffement. Et sa chambre le suffoque. Martine a pris l’habitude de laisser la chandelle allumée. « Kouèss qui’a a à avoir peur de tout d’même ! » Même les veilleuses étaient hors de question. On ne peut pas se fier à une lumière en forme de petit tigre capable de transpercer la nuit.
Alors la chandelle était retournée sur le bord de la fenêtre, sa flamme dansant au gré des courants.
Consciente de son incapacité à changer la nature du monde pour son frère, Martine avait quitté la pièce. Et très conscient de son incapacité à changer la nature du monde pour tout le monde, Ben était sorti du lit pour s’enfuir.
—–
C’est comme ça qu’un soir de semaine réchauffé par la fin de l’été, Ben s’était ramassé dans le fond de la rue Seymour. Mais si la méthode nous est maintenant connue, le motif nous échappe encore. Parce que Ben, malgré toute sa désorganisation prévue, n’avait pas quitté la menace anodine de la chandelle pour le simple bonheur de voir rouler le velours qui a léché les fesses de Jeanine pendant 20 ans.
Non. Ben est en mission. Il le sait, le sort de la ville est entre ses mains. Il le voit depuis quelque temps, malgré les incorruptibles chandelles et les traîtres veilleuses, malgré les lampadaires du boulevard L’Assomption, malgré la Rivière de fierté, la ville s’assombrit un peu plus, jour après jour. Ben comprend que leur monde manque de lumière. Que devant les ténèbres, la résistance s’est tue.
Ben regarde autour de lui. Il doit la trouver. Il sait qu’elle est là. L’alcôve.
—–
La nuit a pris forme par un crack, un smack et un arak.
Billie s’était endormi. Encore. Les heures de travail s’entassent les unes sur les autres pour former un édredon assez doux pour l’hypnotiser et l’étouffer. Il s’était réveillé un bras par terre, le reste du corps sur le sofa. D’une main, il avait ramené sa lourde chevelure dans une queue de cheval pendant qu’il enfilait de l’autre deux souliers à talons hauts pervenches avec des boucles en or.
Trop ?
On lui avait dit de prendre ses cliques et claques. Il avait pris ses galoches et ses cartes et s’en était allé direction Moncton, la ville qui se découvre, la ville de la Rivière de la fierté. Ce soir comme tous les soirs il dansera jusqu’à ce que les cheveux lui tombent dans le visage. Il ondulera jusqu’à ce que ses pieds arqués mesurent la cadence de son cœur. Il folâtrera jusqu’à ce que quelqu’un s’intéresse à lui. Jusqu’à ce qu’un de ses souliers s’affaisse sous le supplice, crack. Jusqu’à ce qu’une paire de lèvres épaisses l’emprisonnent avec un bruit baveux, smack. Jusqu’à ce que l’arak ramené d’Asie par sa mère se vide d’un coup de coude. Jusqu’à ce que ses cheveux lui collent au visage et que ses souliers lui pendent au bout d’un bras.
Il n’avait rien trouvé dans la Rivière ni dans le mascaret. Peut-être parce qu’il n’y avait rien perdu non plus.
Ses pieds nus frôlant l’asphalte, il prend le chemin de la maison. Sa bouteille est finie, sa joue sèche et collante et son soulier esquinté. Il prend à gauche au lieu de droite, droite au lieu de gauche, derrière au lieu de devant, il repousse ses cheveux et les ramène ; l’arak fait une virée dans son sang.
Autour de lui, un stationnement et de la brique. Devant lui, un saoul et un pouf. Comment est-il arrivé ici ? L’espace d’un instant, il pense pouvoir enjamber le saoul. C’est si simple, il suffit de lever la jambe, de la passer par-dessus et de s’écrouler ensuite de tout son long. Il ne restera plus alors dans sa main que le talon de l’autre soulier, sans le soulier, et quelques cheveux, sans le toupet.
Il se relève de peine et de misère. Plus misérable que peiné. Il tend la main pour reprendre l’équilibre, mais ses doigts s’enfoncent. Lorsqu’il regarde, c’est pour se rendre à l’évidence, il tient un scalp. Avec des yeux.
—–
Ben voit la nuit à travers ses mèches et la main. Ce contact, il ne l’avait pas prévu non plus. Devant lui, un homme immense repose tout son équilibre sur sa tête. Ses cheveux volent sous le vent comme une aurore boréale éteinte. Il empeste l’alcool et le riz. Mais Ben le trouve beau. Sous les arcades sourcilières bien dessinées, des cils épais, un nez aquilin, une bouche mince. Les joues sont lisses, si lisses que Ben peut les sentir. Elles sentent le baume après-rasage et la transpiration. Elles sentent le smack mouillé d’un homme parti trop lentement.
Alors, de ses deux mains, Ben prend la main de l’inconnu. Il se dirige ensuite vers un coin de la rue plongée dans l’ombre. Le saoul derrière eux dodeline tranquillement sur le pouf. Lorsqu’il ouvre un œil, il voit seulement un garçon sombre et une grande ombre aux jambes élancées, les cheveux portés par le vent. Les deux se dirigent vers un coin, loin de lui, dans le noir. Il referme les yeux. Le pouf sent Jeanine.
Ben et Billie se tiennent par la main. Devant eux, tout est noir. Ben tire doucement. L’autre suit. Il se dirige vers un coin, un espace abonné entre un stationnement, deux murs et un escalier de fer. Un coin qui n’existe plus parce que personne ne l’a vu. C’est lui que Ben cherchait.
—–
L’enfant retire le sac qu’il portait sur le dos. Un gros sac en ciré noir. D’une délicatesse qu’on ne connaît pas aux enfants, il en retire une boîte plate. L’homme regarde la boîte. Puis ses mains. Le talon. Il le dépose doucement sur un rebord de ciment. Il se penche ensuite sur le garçon et tend les mains. Deux yeux le regardent, mais le reste est immobile. Alors l’homme prend la boîte et l’ouvre. À l’intérieur, un amas de papier bulle cache un enseigne en néons. Un fil avec la fiche électrique s’en échappe. Une main se pose sur son bras alors que le garçon se hisse pour attraper la fiche. Il s’éloigne ensuite, et à chaque pas de l’enfant, l’homme roule l’enseigne sur elle-même pour libérer le fil. Le néon grésille soudainement et s’allume. L’homme tient dans ses mains les promesses d’un toit en paille, d’un martini couleur de soleil couchant et de fesses rendues lisses par le sable.
Tout est flou.
Il pleure.
L’enfant lui prend l’enseigne des mains. Le palmier en néons et son nuage bleu électrique flottent quelques centimètres au-dessus du sol avant de s’élever. L’homme voit l’enfant, sur le bout des pieds, se tendre de tout son long. Et retomber. Seul. Les bras pendants. Et là dans le coin, dans une alcôve formée par deux murs de briques, un dessous d’escaliers en fer et un rebord de ciment, le néon flotte, radieux.
« J’care plus pour une chandelle, ben a s’rait éteinte. So, cette veilleuse… c’est l’best. »
L’homme entend l’enfant. Sous ses pieds, l’herbe de ce petit coin perdu lui chatouille doucement les orteils. Ses jambes lâchent, doucement. Et alors qu’il attend le contact de son corps avec la terre, c’est un doux velouté qui l’accueille, et ça sent Jeanine. Sous lui, le pouf échappe quelques poils et se stabilise.
Le saoul se tient en droite oblique. D’une voix aussi cristalline qu’une bouteille de vodka, il claironne « Ch’quelqu’un a d’jà dit “Néons néons muettes résistances du cri de l’homme pour abolir les ténèbres de ses ombres“. »
Le saoul regarde le palmier et son nuage avec des yeux humides. Sa voix est étrangement droite. Plus que son corps. Il tire sur ses poches remplies de feuilles. Des pages de livres. Il les chiffonne de ses mains, les remet dans sa poche, marmonne une autre citation, sort un gland de sa poche, le dépose au sol devant le néon et repart, le corps affrontant le monde en oblique.
—–
La rue Seymour est une rue en attente. Elle attend le mascaret dont elle aime le bruit et l’odeur. Elle attend le saoul, le garçon et l’homme. Elle attend qu’on s’y perde et qu’on s’y retrouve. Elle attend la nuit.
Dans le coin, entre deux murs de pierre, un néon s’allume à la même heure tous les soirs. Son palmier est maintenant en partie caché par les branches d’un chêne rouge, à peine plus grand qu’un adolescent. De ses feuilles la ville respire, de son tronc elle se bâtie. Et inexorablement, le néon montre le chemin, sa lumière grelottant sous le coup des secousses qui empêchent l’électricité de bien circuler.
—–
Hier, un homme est mort. On l’a enterré avec des souliers pervenche, ses longs cheveux blancs flottant au-dessus du cercueil. Sur son poignet, un vieux tatouage montre un palmier et un nuage. Quelqu’un viendra déposer des fleurs sur sa tombe. Et des glands.
—-
Seymour attend. Elle attend les chercheurs de lumière.
A. Fleury
publié dans le numéro 33. Cris de terrestres