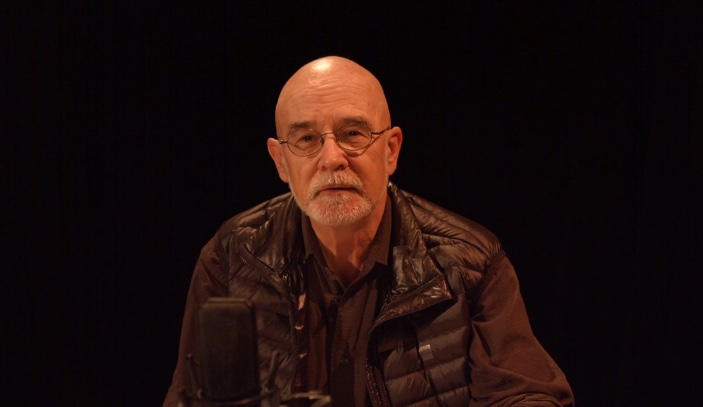Ce jour avait été, en son entièreté, plutôt… terrifiant…
Je n’avais pas fermé l’œil de la nuit – à nouveau, une inexorable insomnie s’était accrochée à moi. J’ai fait une marche dans les rues d’un Digby ensilencé par la fermeture des magasins – ceux qui avaient, malgré tout, maintenu leurs activités. J’avais espéré que peut-être l’insomnie, si accrochée à mes talons, tomberait dans une des piles d’ordures, ou dans un caniveau, ou serait emportée par les vents chauds de mauvais augure. Au lieu, j’ai commencé à avoir faim, m’étant arrêté devant le Crow’s Nest, fermé, aux vitres brisées, dont un menu demeurait collé près de la porte. J’y avais mangé l’année dernière… de la bonne bouffe de Diner qui était demeurée à prix raisonnable malgré notre époque. Lorsque je suis retourné à la chambre d’hôtel que l’on m’avait attribuée, j’ai grignoté ce que j’avais apporté dans mon sac, puis j’ai pris une longue douche chargée du lourd parfum de vanille du nouveau shampoing que j’avais acheté, puisqu’il n’y en restait aucun autre dans les magasins (je ne l’aurais pas acheté autrement). J’ai bu une tasse de thé à la camomille en regardant un film que j’avais dans mon ordinateur (et qui allait assurément être d’un ennui atroce, même si un ami me l’avait recommandé ; un de ces films français psychologiques où les personnages ont l’air fâchés, buvant du café et fumant des cigarettes roulées à la main pendant une heure et demie sans atteindre la moindre résolution) … Puisque le film ennuyeux ne m’avait pas endormi, j’ai pensé lire quelque chose de bon : ma promenade dans la nuit noire m’avait rappelé Ginsberg avec son “dragging themselves through the negro streets at dawn”. Howl And Other Poems était dans mon sac ; j’avais choisi de l’emporter avec moi, puisqu’il s’agit d’un des rares livres que je peux relire fois et fois encore, sans m’en lasser.
Rien n’avait aidé. Le matin, mes yeux étaient d’un rouge vif fluorescent, et tout le monde pensait que j’étais complètement givré. Bien sûr, je n’étais pas givré, juste totalement paniqué. Je devine que le stress avait rougi mes yeux plus que l’insomnie ; j’étais habitué à ne pas dormir, mais je n’étais pas habitué au stress. Ou plutôt, comme tout le monde, j’avais choisi d’ignorer le stress, de rejeter les sources de stress, et de vivre ma vie de tous les jours dans une fantaisie, tralala au pays des merveilles.
La seule personne à m’avoir fait des commentaires, c’était le chauffeur du minibus auquel on m’avait affecté. « Pas un peu tôt pour s’en allumer un, hein ? » a-t-il plaisanté, usant des dernières bribes de bonhommie qui lui subsistaient. « J’ai juste pas pu fermer l’œil de la nuit, » j’ai répliqué. Par « hé, l’ami, je blague pas. C’est moi qui vais conduire, alors toi tu te cargues dans ton siège pis tu relaxes. Si t’as besoin de t’éclater une couple de pétards pour te sentir mieux, tu fais pareil comme tout le monde d’autre, alors fais ce que tu sens que t’as besoin, » indiqua-t-il qu’il ne me croyait pas, et qu’il ne jugeait pas. Sa bonne humeur et son bagou maritimien me rendirent triste, même si ça peut sonner étrange. Je ne voulais pas quitter mon chez-nous… Et encore, très certainement, personne d’entre nous, dans ce véhicule, dans la province, ne le voulait. Il a dû lire les émotions sur mon visage, car il m’a donné une tape sur l’épaule et m’a promis de m’offrir le premier choix de siège dans le véhicule – seule récompense minable à sa disposition.
Ces émotions négatives, je les connaissais trop bien – j’aurais aimé ne plus me sentir mal constamment. Pendant combien de temps une personne peut-elle se sentir mal constamment ? Cela faisait déjà une semaine qu’un minibus similaire m’avait conduit de Baddeck à Oxford… Ou, c’est-à-dire, nous nous étions arrêtés à Oxford. Nous étions censés prendre un train d’évacuation pour aller à Moncton depuis Amherst, mais l’hyper ouragan Smith était arrivé en avance – il n’y a pas une chose qui ne semblait pas se passer en accéléré, puisque nous avions écouté… si nous avions écouté, les projections des meilleurs cas, au lieu de croire au potentiel et probable pire, les worst-case scenarios. Du personnel militaire avait signalé que nous devions nous arrêter à Oxford, une jeep nous avait escortés vers un garage transformé en abri ; « Amherst est sous l’eau, » qu’ils avaient dit. Dans l’immédiat, nous avions cru à une inondation momentanée – des vagues massives, des pluies torrentielles, éventuellement écoulées… Mais il paraît que la tempête était si violente, et a continué de l’être tandis que nous étions à l’abri, que la terre molle de Chignectou avait cédé. Ce n’était pas juste que Amherst était sous l’eau, c’était qu’en grande partie, il n’y avait plus de Amherst, et il n’y avait plus de Chignectou. Les sols s’étaient ramollis, désagrégés, les immeubles s’étaient écroulés, les terrains avaient glissé, avaient disparu en mer, partis avec les déluges ; pour tout dire, il ne restait plus de Amherst, il ne restait plus de Chignectou.
Si nous avions de la difficulté à le croire, les militaires affirmaient que de façon définitive, il serait impossible que qui que ce soit passe vers le Nouveau-Brunswick. Ceux comme moi, qui avaient jusqu’à présent refusé d’être évacués, ne pouvaient, de par-delà la force des vents et la virulence des vagues, atteindre l’intérieur des terres et des lieux en sécurité. À ce point, j’étais à Oxford, et l’évacuation par la route était impossible : il n’y avait plus de route. Pareillement, les trains en partance de Halifax et de Truro avaient été stoppés, et vraisemblablement, ne seraient jamais plus en mesure de quitter.
Après le passage de l’hyper ouragan Smith, les bateaux de pêche fonctionnels (ceux qui n’avaient pas sombré, ceux qui n’avaient pas été renversés sur les quais, ou balancés sur les côtes), ont évacué des gens du Cap Breton et de la côte nord vers le Nouveau-Brunswick, ou du moins, c’est ce que j’ai entendu… Les téléphones n’avaient plus de réception, l’internet refusait de fonctionner. Avant, je n’avais jamais vu une utilisation aussi grande des radios CB, même si la moitié du temps leur son était inaudible. Il restait deux semaines avant le passage d’un prochain enfer d’une tempête tropicale, et celle-là devait être encore plus dévastatrice…
Dans le véhicule en route vers Digby, il y avait beaucoup de spéculation sur ce qui resterait après la prochaine tempête. « Nous sommes déjà une île asteur… C’est-à-dire, deux îles… » – « Et pis ils disent que la prochaine tempête va être plus grosse… plus grosse comment ? On n’avait même pas entendu parler des hyper ouragans une couple d’années passées… » – « Tu sais-tu quoi c’est qui s’est passé à d’autres villes ? Amherst est même plus là… j’veux dire, c’est même pas… » – le conducteur interrompit les spéculations entre les passagers : « Ça qui a été détruit, on le reconstruira. Moi, mon arrière-grand-père était là pour reconstruire Halifax après l’explosion en 1917, et on va faire la même chose avec toute ça qui est en train de se passer maintenant… ou en prochain… » affirma-t-il, se tissant un imaginaire lien de résilience génétique. « Sauf que l’explosion d’Halifax avait pas duré des jours, répété fois et fois encore, pour anéantir à nouveau ce qu’on aura pu reconstruire, et le sol même sur lequel on se tient, » j’ai pensé, sans oser le dire à voix haute.
Après ça, ils m’ont attribué une chambre d’hôtel, on avait deux jours d’attente, d’insomnie, et puis un autre minibus. Digby avait été miraculeusement épargné suite à l’hyper ouragan Smith ; malheureusement, Saint-Jean n’avait pas eu autant de chance. À ce qui paraissait, le port avait été ravagé ; c’est pour ça que le traversier n’y allait pas. Au lieu, l’état du Maine avait ouvert ses portes à tous les Néo-Écossais, proposant de l’aide pour nous relocaliser à l’intérieur des terres, aussi vers d’autres états qui tendaient une main charitable en réponse à notre appel au secours.
Je n’avais aucune idée vers où j’étais destiné ni pendant combien de temps j’allais y être. Pour le moment, seulement une des trois tempêtes géantes en trajectoire pour la Nouvelle-Écosse avait frappé… Et encore, le mois dernier, il n’était censé en avoir que deux ; la troisième s’est formée rapidement, sans être prévue. Et quelle dévastation résulterait de leur passage ? Aurais-je quelque part où retourner, quelque chose vers quoi revenir ? Étrange, comment l’année dernière, lorsque nous avions accepté des milliers de réfugiés de Haïti et de la République Dominicaine, nous ne nous attendions pas du tout à être à leur place…
Le bateau dans lequel l’on m’a empaqueté était beaucoup plus petit que le Fundy Rose – réquisitionné, ce nouveau bateau, récemment complété par les chantiers d’A.F. Thériault à Meteghan River, était circulaire, n’était pas (d’après les rumeurs entre passagers) conçu pour le large marin, puisqu’il devait servir de nouveau lien entre Halifax et Dartmouth… « Ça doit être sécure », je me suis dit, « soit ça, ou c’est leur dernière option et ils sont vraiment désespérés… » Nous devions accoster à Belfast au lieu de Portland pour raccourcir notre trajet.
C’était à l’intérieur du bateau, incessamment pilonné par d’énormes vagues, qu’elle s’est concrétisée en moi, la notion que toute cette journée avait été terrifiante, ces derniers jours avaient été terrifiants… mais rien n’était aussi terrifiant que les jours à venir. Et pourquoi est-ce que cela se concrétise pour moi lorsque, forcé de fuir mes contrées, mon chez-nous, ma province, cette magnifique bande de terre qui, durant des millénaires s’était accrochée au continent avec toute sa force, désormais, en périphérie de notre catastrophe climatique, était au premier rang de l’anéantissement ? J’ai été si bête. Je me souviens du livre L’équilibre sacré de David Suzuki « Nos identités incluent le monde naturel, comment nous nous déplaçons dans celui-ci, comment nous interagissons avec celui-ci, et comment il nous préserve. » Maintenant que mon monde naturel disparait, qui suis-je ? Battu par des vagues, dans un bateau probablement trop petit ou pas assez puissant pour le voyage prévu, obligé, car notre chez-nous s’apprête à être balayé par des tempêtes d’une envergure inimaginable il y a dix ans… Il y a dix ans, lorsque nous pensions que nous allons être « oké » si la température moyenne augmentait de deux, quatre, six degrés… Pour quelle raison, voulons-nous agir seulement lorsqu’il est trop tard ?
Thibault Jacquot-Paratte
publié dans le numéro 32. J’écris ton nom