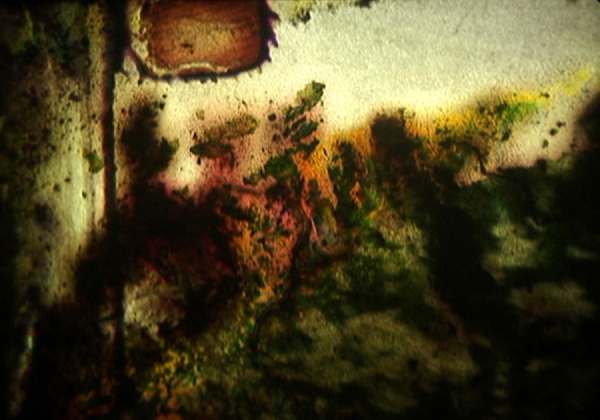
Le car touristique
Ils étaient beaux ces jeunes gens, ils étaient beaux, puant le soufre.
C’était un jour, un car à deux étages est parti avec des touristes, leurs appareils photo et leurs maillots Mickey Mouse.
Le champ de bataille gisait non loin, feu rageait sur son terrain ; les herbes brûlaient, les projectiles sifflaient, les morts gisaient sans honneur et sans clameur, mais des étrangers étaient venus les prendre en photo.
La route passait entre les rangs, les bombes la visaient, car la guerre, ça se rentabilise. Tout comme il faut la gagner, c’est une attraction à ne pas manquer.
L’autobus roulait déjà et les bruitages les atteignaient depuis un bon moment, l’arôme subtil de mort et de violence, l’air jovialement irrespirable, de fumée et de boucane, venait juste de les heurter. Ils attendaient impatiemment et gardaient leurs doigts sur les gâchettes de leurs kodaks et leurs caméras vidéo – alors que non loin, derrière les vitres pare-balles, l’on n’attendait rien pour canarder, car si l’on attend de bien viser l’objectif, c’est dans la boue que son croquis s’esquisse.
Pare-balles, oui, bien sûr, car le client, il ne faut blesser ; oh non, le client, lui, vient premier. Mais sur les champs, les ouvriers, ils s’entretuent. Les travailleurs se meurent. L’artisan de la charge, artisan du tir, porteur de casques et de fardeaux ; prendre son portrait avec les cadavres : comme c’est beau ! Quoi que pour un petit pourboire, les gros voyageurs, les ordinaires vacanciers à casquette et au ventre rond de bière, pourraient poser avec de nouvelles gueules cassée !
Après la charge, la chirurgie, un autre boucher, celui-là, il nous veut du bien, et une convalescence malaisée – pendant laquelle nos potes voudraient nos bottes ; notre peau jaunissait, et que l’on devrait y retourner, on le savait – les vulgaires poilus montraient leurs cicatrices, leurs moignons, recrachaient un bout de poumon et montraient leurs médailles pour une pièce de cinq sous – elles ne valaient pas plus que cette fortune à produire – les moments plutôt calmes quand les autobus s’arrêtaient près des tranchées et des casemates.
Il n’y a pas trop jeune pour apprécier se faire beau pour un Polaroïd souvenir avec un corps qui n’est pas encore raidi, dont les blessures ont à peine coagulées, et qui s’ouvrent lorsque l’on le prend par la tignasse pour que le visage soit près du nôtre et regarde l’objectif de l’appareil. Et s’il y en a de trop peureux et faibles de cœur, engueulons-les ! « Apprends à être un homme ! », « Allez, vas-y j’te dis ! ». Ils poussent le gamin de sept ans au bord des larmes vers cette chose pour en envoyer une copie sur papier glacé à grand-mère, qui a fait le même tour il y a quatre ans et qui en garde de bons souvenirs.
Leurs premiers cadavres, les petits pouvaient voir leurs premiers cadavres, les premiers vrais, plus vrais que les mots des effets spéciaux d’Hollywood. Pour certains un plus grand choc, pour d’autres une plus grande satisfaction.
Le bus allait lentement lorsqu’il passait sur le terrain pour que, par les grandes fenêtres, ceux qui avaient acheté leur place profitent des tripes qui se répandaient et des cris qui sonnaient le glas, funèbre au revoir, le requiem de la saloperie d’humanité qui ne discute pas, qui ne se réconcilie pas, qui ne trouve pas de consensus, d’entente. De cette saloperie d’humanité qui trouve à maximiser le profit, qui cherche à créer des emplois alors que le progrès, ce n’est ni la destruction ni le meurtre, et si l’on a une maison vide, autant qu’elle serve à loger avant qu’elle ne tombe en ruine. Et les emplois ont été créés, pourquoi pas ; l’on s’en va en guerre ! Les pauvres et les chômeurs peuvent se faire un nom. Ils peuvent parvenir ! L’ascenseur social par le hasard de ne pas avoir été percuté par un fragment d’obus, par une balle perdue, par un poignard perçant notre dos alors que l’on faisait face à un autre danger. On éradique la pauvreté par l’éradication.
L’honneur que l’on voit gisant la face dans la boue, l’honneur que l’on palpe de si près chaque fois que l’on salue le drapeau, que l’on remercie la nation de n’avoir rien fait de spécial, l’honneur qui ne nous percute pas quand l’on voit la misère, l’honneur que l’on salue quand on justifie la guerre, l’honneur que l’on voit tranché en deux, l’honneur que l’on voit pleurer, que l’on voit traumatisé, que l’on veut abandonner, l’honneur que l’on n’envie à personne, l’honneur que l’on regarde avec appétit – l’honneur que l’on voit rouler, que l’on voit partir.
Le conducteur annonça qu’ils arrivaient près de l’activité. Le son était devenu plus vrai et plus assourdissant qu’à l’approche. Les couleuvrines étaient perceptibles par de vagues étincelles dans les zones les plus enfumées. Chacun se fit artiste de guerre, certains avec plus de succès que d’autres. Les flashes trop puissants se réfléchissaient dans la vitre. Ceux au deuxième étage, des sièges de première classe, avec un toit vitré, voyaient également parfois des zincs les survoler, hauts ou plus bas, à toute vitesse dans tous les cas.
Malgré le système de filtration d’air, une odeur subsistait tout de même dans le car, et certaines grosses madames, et des messieurs très importants placèrent des mouchoirs, des mouchoirs blancs, devant leur nez.
À l’arrière du premier étage du bus, il y avait un confiseur. Il vendait du maïs soufflé tout comme des bonbons, des réglisses, de la pâte grise, des bretzels et des boissons. Coca-Cola ou Pepsi ? Ces grandes marques qui avaient le monopole de la chaine ! Mais de toute façon, qui voudrait autre chose ? Auriez-vous du Fanta ? Et lors de l’achat, il faut demander quelles tailles ils veulent. Une taille plus grande ? La plus grande ? Bien sûr ! Le cinquante centimes de plus couvre le coût total de la production de vos achats, et même plus. Ils se lèvent pour aller à l’arrière et parler au jeune boutonneux sauvé du front par son uniforme à chemise noire ornée de son nom et de l’emblème de l’agence touristique, et commander sans « s’il vous plaît » ni « merci », et en payant avec de grosses coupures sorties de la banque avant qu’ils ne montent dans le bus. Ils retournaient s’assoir dans leur siège, les mains trop pleines, posant leur boisson dans le trou béant prévu à cet effet dans leur accoudoir, et après avoir pris une poignée de gourmandises, la bouche pleine, ils parlent. Les enfants demandent aux parents d’en avoir eux aussi, les parents donnent des billets aux enfants pour qu’ils en aient aussi. Les enfants ne partagent pas entre eux, les parents donnent le même montant à chaque enfant pour qu’ils aient les leurs. Les enfants veulent la même chose que les autres pour se conformer, ils veulent aussi quelque chose d’autre que les autres pour se différencier. Pour être mieux ? Les parents s’en foutent.
Si pendant le trajet, il s’adonnait que des affrontements à baïonnettes à bout d’armes aient lieu, alors le chauffeur de bus les klaxonnait pour leur rappeler qu’ils ne devaient pas être sur la route, qu’il avait un tour à faire faire aux gens, et si un macchabée restait sur le pavé, alors il n’y avait le choix que le contourner ou de le dégager lui-même, plutôt que de risquer qu’il passe dessus, il puisse rouler sur une grenade ou quelque chose du genre, faisant exploser la cargaison de gens importants, pas que les touristes n’aient pas essayé de lui refiler des pots-de-vin pour écraser le pauvre bougre (il était déjà mort après tout, et ça aurait été intéressant, écraser un homme !). Le chauffeur de bus résistait. Les touristes, eux, des salariés qui méritaient des vacances, qui avaient payé pour leurs vacances, il ne pouvait pas les risquer.
Les soldats, eux, merde aux vacances, ils auraient leurs vacances une fois la guerre gagnée. S’ils voulaient des vacances, ils n’avaient qu’à rester chômeurs, dire s’ils aiment ça. S’ils voulaient se tourner les pouces, ils pouvaient bien déserter, voir en prison s’ils aimaient ça se tourner les pouces.
Quand des balles venaient heurter l’autobus, la foule émettait en chœur de petits cris comme dans l’admiration de la réalité de la chose. Des hommes à la coupe en brosse grise, en polo de marque Lacoste, bien orné d’un petit alligator pour que tout le monde puisse le reconnaître tout de suite et sans effort, se levèrent pour aller s’appuyer de leurs bras brûlés par le soleil, cramés en jouant au golf, contre les sièges en faux cuir authentique, bien rembourrés, pour se pencher et regarder par les grandes vitres à-peu-près là où les balles avaient rebondi – ne voyant bien sûr, rien – les cartouches venues de loin, laissant sur la carlingue des marques invisibles pour ceux à l’intérieur. Quand le bus s’arrêterait, ils prendraient bien sûr des photos à côté de ces marques. Il y aurait un homme dans la cinquantaine dans le bus qui sermonnerait tout le monde qui serait en train de se demander d’où les balles venaient, en leur disant que les gens ignorent souvent le fait que des balles peuvent parcourir des kilomètres avant d’aboutir en un lieu aléatoire, dans des têtes aléatoires. Cet homme, évidemment, se considère bien supérieur à tout le monde, cet homme joue beaucoup plus au golf que tout le monde. Cet homme est un alcoolique, mais il en a le droit ; cet homme est d’une arrogance insupportable.
Après avoir rendu visite à un des camps, le bus irait dans l’autre camp. Les femmes poseraient des questions sur le style de vie des soldats, beaucoup d’entre elles ayant payé des fortunes colossales pour aller tenir de petits Africains affamés dans leurs bras, pour pouvoir revenir et dire qu’elles les ont « aidés », depuis ce temps avide de causes sociales et de modes de vie à plaindre, aimant plaindre, et aimant pouvoir dire, pour les autres presque plus qu’à elles-mêmes, qu’elles sont de bonnes personnes qui font le bien autour d’elles, qui se sont souciées et qu’elles plaignent les soldats, espérant que la guerre finira même si elles ont donné leur argent pour qu’elle continue, tout comme elles n’avaient rien foutu pour les pauvres et les pays en développement dans leur jeunesse ; et les hommes, pour se rendre intéressants, essayeraient de discuter politique et stratégie avec les soldats. « Où pensez-vous qu’ils attaqueront ? » Certains d’entre eux se prendront assez au sérieux pour leur donner des conseils, comme s’ils y connaissaient quelque chose. Ils regardent des émissions à la télé où l’on compare des fusils et des chars d’assaut, alors ils savent ce qui est mieux. Les soldats ont envie de les étriper. Ils ont envie de signer leur propre traité de paix, mais ils ne savent pas pourquoi ils ne le font pas, ils ne savent pas ce qui arriverait. Tout comme l’on hésite avant de demander à quelqu’un de sortir avec nous, tout comme l’on hésite avant d’épouser la personne avec qui l’on habite depuis dix ans, un pas à franchir, une frontière ; d’un côté, ils font différemment, ils calculent la distance en miles ou en kilomètres, ils parlent en onces et en gallons ou en litres, de l’autre côté ce n’est pas pareil, c’est peut-être aussi bien, l’on est tous certains d’habiter dans le meilleur pays au monde, jusqu’au jour où on se rend compte que c’est de la merde – mais lorsque ce jour est arrivé, par où s’y prend-on ? On peut avoir des idées, mais les expliquer c’est une autre histoire. Les soldats aimeraient bien étriper tous ces faux-culs. Ils aimeraient bien voir les généraux sur les champs de bataille, ils aimeraient bien voir le ministre de la Défense lancer ne serait-ce qu’une grenade. Les soldats en ont assez, mais il y a une frontière à traverser, et la mort nous traverse avant.
Les enfants, eux, ils admirent un peu ces soldats, ils voudraient être comme eux, être à leur place, ne se rendant pas compte qu’ils mangent mal et qu’ils ne se sont pas lavés depuis trois semaines, et que c’était dans une eau de pluie boueuse qui stagnait dans un trou laissé par une explosion. Certains des soldats aimaient les enfants avant. Ils aimaient leur faire plaisir et les faire rire, certains d’entre eux avaient des enfants, ils les ont toujours, peut-être. Mais les enfants les dégoûtaient à présent. Parfois, ils pouvaient les truquer pour avoir un paquet de réglisse, un morceau de chocolat. « Tu peux porter mon casque pour tes friandises ». Que risquaient-ils ? Se faire engueuler par des parents ? Quand tu as vu des mecs se coucher sur des grenades pour sauver un bataillon, tu n’as plus trop peur des parents. Les chauffeurs de bus, eux, par contre, ils avaient appris à séparer les parents mécontents des soldats depuis qu’un soldat avait tué une famille, une fois. Les soldats s’étaient tous mis ensemble pour se couvrir . Le coupable s’en est sorti avec la simple punition de continuer d’être un soldat. Comme ils avaient tous été contents par contre, les soldats.
La compagnie, heureusement, avait déjà pris les dispositifs nécessaires. Chaque voyageur acceptait automatiquement dans les termes et conditions des achats de sa place que la compagnie n’était aucunement responsable si quoi que ce soit arrivait, sachant très bien que des bus blindés ne pouvaient pas tout arrêter.
Dans le bus il n’y avait pas de musique, mais dans les accoudoirs, les passagers pouvaient brancher des écouteurs pour accéder à toute une sélection radiophonique. Une chaîne donnait également accès aux communications radio du champ de bataille. Cela permettait d’avoir un audio qui ajoutait au peu qu’ils pouvaient voir. Les cris, les sifflements de l’arsenal, les râles de douleur, les ordres, les positions – l’intégralité des communications sur le vif des deux côtés était disponible aux touristes. Toutefois, une bonne partie d’entre eux avaient leurs propres appareils électroniques et leur propre sélection musicale. Leur confort et l’aventure de la vraie guerre juste pour eux.
À la fin du voyage il y avait une boutique souvenir dans laquelle on pouvait acheter des répliques de casques ou d’armes, des peluches en forme de soldats défigurés, des drapeaux nationaux – des deux côtés – des articles de mode pour que les adolescents puissent arriver au lycée avec des bottes de militaires payées quinze fois le prix qu’elles auraient coûté dans une boutique de surplus de l’armée, le même type de bottes que des gens ne portent pas par choix, et aussi des vestes, des bonnets, etc.
Et les gens rentreraient. Ils diraient qu’ils étaient contents d’avoir vu ce qu’ils ont vu. Content d’avoir vu les joues pâlies, sales, des taches, des éclaboussures séchées du sang des camarades. Que ce n’est pas tout le monde qui a cette « chance », que c’est rare, qu’ils ont bien dépensé, qu’ils ne vont pas y retourner d’ici demain, que c’était un bon choix pour eux, que c’était beau par moment, que c’était bien pour les gamins. Les pères sont contents, ça inspirera aux enfants de travailler fort et de devenir avocat ou d’avoir une compagnie de tourisme, ou n’importe quoi tant qu’ils produisent du fric. Que si les gens sont pauvres et soldats et qu’ils doivent faire la guerre, c’est qu’ils ne travaillent pas assez fort, c’est qu’ils manquent d’initiative, et que les incitatifs d’être officier ne sont pas assez forts. Que sans l’incitatif de rester en vie, ils ne feraient même rien ! Les pauvres, il leur faudrait cet incitatif, qu’ils disent ces gens qui rentrent chez eux, défaisant leurs bagages, ces gens qui n’ont jamais travaillé à passer la serpillère dans des dépanneurs ou à pelleter du fumier dans des étables, des gens qui ne savent pas combien d’heures vont à produire les aliments qu’ils mangent en bénissant Dieu et Jésus d’entretenir par sa grâce le pauvre esclave qui les a produits, puisqu’eux, ils ne feront pas plus que ce dont ils ont besoin.
C’était un jour où un car touristique, comme bien des cars touristiques, est parti pour faire le tour d’un champ de bataille pour que des gens puissent voir comment ça se passe.
C’était un jour où des gens purent continuer de se positionner dans leur confort et leur sécurité pour se dire qu’ils étaient de bonnes personnes et qu’ils étaient intouchables.
C’était un jour différent des autres jours dans la vie de ces personnes, car ce jour-là, ils pouvaient voir les autres gens ramper, contrairement aux âmes qui se traînent le long de la rue se demandant quoi faire pour mieux vivre le jour d’après, crevant la dalle, démangés par une faim qui a été écrite, mais pas assez lue.
C’était un jour ordinaire pourtant, où le temps passait, les gens se crachaient dessus, où les gens se tiraient dessus, et où des gens observaient la mort dans des sièges bien confortables, des positions bien protégées, sans garanties pourtant, sans garanties.
C’était un jour, un car d’une compagnie touristique a fait faire le tour d’un champ de bataille, et les touristes ont pris des photos de ces jolis jeunes gens qui étaient beaux dans la merde et le sang, qui étaient beaux le soufre puant, qui avaient la trouille et qui travaillaient quand même, qui seraient payés pour leurs plus qu’humbles services – qui seraient payés moins bien que le chauffeur du bus.
Thibault Jacquot Paratte
Texte publié dans le No 13. Fragments d’humanité



