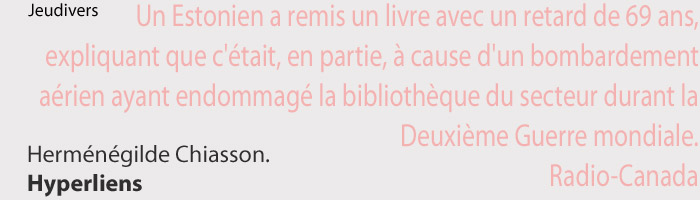par Jean Babineau
À Hélène Bourassa
Un homme est évidemment composé de différentes strates ; dès son premier recueil, Roadkill à 30 kilomètres par seconde, Ronald Léger exprime cela :
la réalité du moi vague
vers la côte invisible
d’un passé géographiquement solide1 [.]
Lorsque Gérald Leblanc se demande à la fin de son fulgurant recueil L’extrême frontière « qu’est-ce que ça veut dire, venir de Moncton2 ? », on pourrait bien réciproquer avec « What the heck ? Tu viens d’East End ? Far out ! Cool ! » On connait bien la dialectique leblancienne de l’extrême frontière, de Moncton, avec sa « langue bigarrée à la rythmique chia[que]. encore trop proche du feu. la brûlure linguistique3 ». Mais qu’est-ce que ça veut dire, venir du East End de cette ville ?
Ronald Léger, c’est BBeyes : c’est sous ce sobriquet qu’on le connait dès son jeune âge dans le quartier est de Moncton. Ce nom tire son origine d’un personnage de la bande dessinée Dick Tracy. Dans ce quartier, un nickname anglais était souvent accolé sur notre carapace de caméléon chiac. Cela devait contribuer à notre survie. Mon premier souvenir de Ronald remonte à la cinquième année, dans la classe d’Alexina Leblanc, au sous-sol de l’école Aberdeen, où il s’est assis à même le plancher en béton dans la position du lotus, puis s’est mis à marcher sur ses genoux. Il aimait bien rire et faire rire.

En mai 1971, Ronald et moi avons parcouru les écoles secondaires de la province pour encourager les élèves à envoyer des poèmes au Cercle littéraire La Sagouine formé par trois étudiants en maitrise, Adrice Richard, Pierre Roy et Gérard LeBlanc. Plusieurs des poèmes reçus sont parus dans La Revue de l’Université de Moncton4 en 1972. À cette époque, Ronald écrivait de la poésie et aimait en lire dans des fêtes bien arrosées ou boucanées de fins de semaine. Pendant et après ses études en littérature comparatives à Sherbrooke, il écrivait plutôt en anglais, puis est revenu au français. Lire ses poèmes à quelqu’un lui était une réelle source de plaisir. L’ironie et le détournement de la nature des mots le régalaient, comme le démontre son premier poème dans Roadkill : « coquillages et crustacés/poissonnent/océans et lacs couchent d’ozone » (R, 8). Le changement osé de la nature du nom poisson en le néologisme verbal « poissonnent », figure d’acrobatie stylistique souvent pratiquée par Léger, annonce par ailleurs le titre de son troisième recueil, Les poissons s’arêtent5.
Si Roadkill tire son titre d’un accident d’un animal sur la route, et Les poissons s’arêtent, d’une entorse orthographique, tachyAcadie, le deuxième recueil de Léger, détient le sien d’une crise de tachycardie de l’auteur, d’où cette strophe cacophonique qui ouvre et le ferme le poème « Acquis quoique toi » :
à qui que tu
à qui que tu te
à qui que tu te tues
à qui que tu te tues toi6[.]
Ce poème, souvent cité comme un des plus connus de l’auteur, exploite l’usage de la répétition comme un battement excessif qui donne lieu à ce genre de crise. Les consonnes résonnent dans la vie comme dans les mots pour Léger, qui accorde à l’écriture une importance vitale, lui qui « aimerait s’écrire // avant de [s’]effacer (ps, 73).
Le titre du manuscrit posthume, Je friboule, dont certains poèmes sont publiés dans cette édition d’Ancrages plus de trois ans après la mort du poète, est composé du pronom « je » et du verbe néologique « fribouler », ce qui ouvre un éventail de significations possibles. Le poète lui donne un sens, protéiforme parmi d’autres, dans ce poème du même nom où mon ami écrit :
je friboule
au Deluxe French Fries
quand tu peux pas orderer
avec ta langue
dans ta langue[.]
Ce commentaire sociolinguistique pertinent devient toutefois tout autre dans la prochaine strophe :
je friboule
quand la richesse suce
le sable entre les dents
et entre les tombes
où la sensation exprimée par le verbe fribouler se trouve porteuse d’une sublimation métaphysique.
Dans ce recueil inédit cohabite une variété de textes : des courts, des longs, en vers et en prose avec l’humour et les artifices qu’on lui connait. De plus, on relève chez Léger, cet amuseur de mots, bon nombre de considérations humoristiques, telles que :
on peut prendre un galet
pour en faire un palet
on peut prendre un gars laid
pour en faire un gars pas laid
ou
on peut prendre une galette
pour en faire une palette[.]
Dans le poème composé de dix parties intitulé « Souvenir de Fess Parker », qui emprunte son titre à un acteur reconnu pour avoir interprété les rôles de deux pionniers du Far West dans les années 1950, Daniel Boone et Davy Crocket, Ronald raconte ses expériences d’enfance :
2
j’viens de l’East End de la ville
on avait de la fonne
quand j’étais jeune pis fou
5
on s’amusait à jouer aux cowboys
pis aux indians dans
des p’tites guerres
qui nous faisaient manquer notre dîner
pis attraper une lickin
des fois on jouait
à Treasure hunt ou à Rescueight[.]
8
en arrière de chez nous
y’avait un gros checkerboard
noir et blanc
c’était un dead end
on s’amusait à grimper dessus
ride ’em cowboy
Pour une génération de l’East End qui a grandi devant le téléviseur, alors que dans les années cinquante, il n’y avait que trois postes de télévision et que plusieurs émissions tournaient autour de figures de cow-boys étatsuniens, les cowboys du Far West et leurs histoires rocambolesques finissaient par teinter considérablement l’imaginaire et les jeux qui s’ensuivaient : lorsqu’un objet pouvait être chevauché, nous le chevauchions, d’autant plus que les chevaux étaient une denrée inexistante dans l’East End. Dans « le remord amer d’un cowboy d’la rue King », pendant « la drive back » à Trois-Rivières où il habite, Léger demande
Renous-moi ouèerre
avec chez nous[.]
L’Acadien qui habite hors de l’Acadie s’ennuie souvent de son chez lui, que ce soit l’Acadie ou l’East End. Dans « voyage à l’est », l’East End se transmue en
l’East End du Canada
l’East End de la planète
l’East End de l’Europe
l’East End de la France
[…]
l’East End de l’Acadie[.]
Le poème « gros vent à P’tit Cap » montre cependant sa joie de ses séjours estivaux sur le bord de la côte où
le drapeau acadien
flagosse au vent[.]
« Parlee Beach », poème qui poursuit l’importante tâche littéraire de nommer les lieux, la plage est comparée à celle de Varadero :
Je pense à Parlee Beach
quand j’étais jeune
et ma démarche sur la plage
démontrait mon sens
de ma propre beauté
Personne m’avait parlé
de la vieillesse qui ronge
et de la beauté qui fond
au soleil
Je pense à Varadero
quand je pense à Parlee
et l’eau froide
d’une chaleur d’été
réchauffe l’eau chaude
d’un trait d’été
au printemps
des riches en vacances[.]
Ce poème contient une réflexion sur différentes étapes de sa vie. Dans la strophe du milieu, l’on peut voir comment l’éducation de la jeunesse en Occident, où l’on mise beaucoup sur la jeunesse, fait parfois défaut en ce qui concerne le dialogue sur le vieillissement. En plus du vieillissement, Léger aborde aussi la mort dans Je friboule ; ainsi, dans le poème « presque un poème à deux », il confie avec une pointe d’humour :
je suis presque mort l’an dernier
j’ai presque fait ma nécrologie
j’ai presque changer le monde[.]
Entre la vie, l’amour, la mort, Ronald est le « poète automatique » qui « navigue » dans la légèreté zen
entre les lettres
et les têtes
entre les idées
et la folie
entre la musique
et la poésie
entre la mort et la vie[.]
C’est un poète qui aime les oppositions :
c’est facile
précaire comme un clou
entre les doigts
et le contraste et la répétition :
le rêve dans ma brain
corbeau corbeau corbeau[.]
L’auteur de Je friboule n’a pas peur de se dévoiler, comme le démontre le texte en prose qui utilise la phrase clé « Je porte le manteau de mon père et les souliers de mon fils » au début de chaque paragraphe pour décrire comment il se sent face à la maladie d’arthrite de son père et de son fils et à l’accident cardiovasculaire qui a fait perdre la mémoire au premier. Selon moi, ce poème est le plus touchant de Léger.
Une de ses forces principales reste son jeu avec la langue, comme dans « MOM » :
Mom Boucher
Mom Coucher
Mom Sauver
Mom Moucher
Mom Soûler
et à propos de ce ludisme, il trace
Un autre poème
un autre mandat
les journalistes
se demandent :
c’est quoi la langue
qui te frippe ?
Ronald était mon ami et l’est toujours puisque je peux toujours lire sa poésie. Les mots peuvent durer aussi longtemps que les roches même s’ils sont plus légers, car ils peuvent être réinscrits. Alors je grille une clope et boit un ron7 jamaïcain à sa santé et j’entends une brise, un léger bruissement provoqué par le vent qui fait frétiller les feuilles de bouleaux et je me dis que ce doit être Ron qui rit et je friboule à ces surgissements récents dans lesquels résonnent toujours sa production poétique.
Texte de Jean Babineau publié dans le no 12 de la revue Ancrages Je friboule. Hommage à Ronald Léger.
1 Ron Léger, Roadkill à 30 kilomètres par seconde, Moncton, Perce-Neige, 2000, p. 59. Dorénavant, les références à ce recueil seront indiquées par le sigle R suivi du numéro de la page placé entre parenthèses.
2 Gérald Leblanc, L’extrême frontière. Poèmes 1972-1988, Moncton, Éditions d’Acadie, 1988, p. 161.
3 Ibid.
4 La Revue de l’Université de Moncton, « Poésie acadienne », 5e année, no 1, 1972.
5 Ronald Léger, Les poissons s’arêtent, Moncton, Perce-Neige, 2007. Dorénavant, les références à ce recueil seront indiquées par le sigle ps suivi du numéro de la page placé entre parenthèses.
6 Ronald Léger, tachyAcadie, Moncton, Perce-Neige, p. 11-12.
7 La première fois qu’il arrive à Cuba, de l’aéroport à la villégiature, il voit son nom inscrit sur des panneaux publicitaires partout, ce qui le réjouit. En espagnol, rhum s’écrit « ron ».