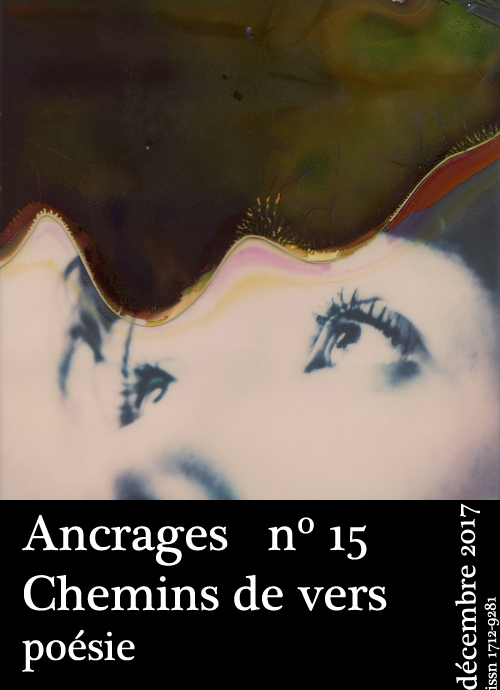Lay me down beneath the wide-branch tree
that I may sprout wings.
Lay me down beneath the highest elm,
that my spirit may rise to see the far horizon.
Or lay me to rest on the long, sandy dune,
That I may see ships come and go (…)
Léonard Forest
Un garçon blond de douze ans
au magasin général
un enclos avec des chèvres
un très long chemin
submergé par moment
la rivière de part et d’autres
les verts translucides
des champs, des marais
en suspension entre la glaise et le saphir
l’opale d’un ciel sans limite
au service des eaux
J’écoute mon père parler de son pays
J’absorbe le silence
Je sais me taire un peu
J’ouvre si grande ma mémoire
qu’elle ne peut saisir
la beauté rouge et profonde
qui s’offre à elle
aussi loin qu’on peut voir
un océan de terre
renvoie sa lumière
Tu bombes le torse
pour ne pas disparaître
tu t’accroches, tu voudrais
me donner le silence du jardin
les murs épais qui protègent
les nœuds du bois de cette table
où je m’attarderai encore
après ton départ
la porte restera ouverte — fermée
On n’a rien à faire de la pierre
Tu marches déjà sur le toit
comme un archet brisé
tu ne peux te défaire
du silence des lieux
tu refuses les portes
les arches sculptées, l’odeur partout
Tu ne veux pas de dieu
tu ne veux pas, les hommes qui disent
Tu te caches de la lumière
ne veux pas qu’elle t’emporte
dans la cathédrale de pierre rouge
tu chantes seul
Tu attends de toutes tes forces
ce dieu que tu brises
avec tes yeux secs, tu refuses ta peine
Il y a dans l’autre pièce
le petit lit de fer blanc du sanatorium
les bras croisés
tu as vingt ans
leurs voiles effleurent
ton visage
te conjurent de rester
En premier je n’ai pas vu
le long de ton échine
cette trace parfaite
qui indiquait le ciel
le poids de ta fatigue
et l’auréole d’argent
posée sur ton visage
les sentiments glissaient
pareils aux fruits trop mûrs
tu regardais
sans trop y croire
cette dernière neige
fuyant l’hiver
comme femme trop belle
noue son tablier
avant d’ouvrir la porte
Il ne faut pas déterrer le passé !
Avait dit ta grand-mère
Alors, tu as enterré les chiens
et les hommes à la tête coupée
dans la poussière et la cendre
d’un champ calciné
Pour qu’altéré
une fois pour toute
on ne puisse jamais anéantir le réel
Pour que reste immuable
par la tête coupée, magnifiée
la bête au poil lustrée
roulée dans la boue
La bête, le sol, le ciel, l’oiseau — recouverts de cendre
de poussière de charbon
Car la seule chose qui reste pour sauver l’homme
c’est la mémoire inaltérable du réel
C’est la mort elle-même implorée
comme une mère disparue
Dans dix ans, dans vingt ans
Dans soixante-dix ans
on déterrera le tableau
avec la boîte en fer
qui contient ses cheveux
il n’aura pas bougé
on ne pourra jamais dire
que cela n’était pas
Personne ne peut plus rien au réel
Désormais on te prend pour un autre
Dans la transparence, la dépossession totale
les murs des prisons ressemblent à ton ciel
Tu connais les couleurs, le fer, les grilles
Tu ne sais pas pourquoi, les prisons
te font l’effet d’un berceau
un ciel de cardamone où l’orage éclate
L’éternité est cet insoutenable chant des marais
Rien ne saurait calmer la peur de ceux qui vont la nuit
Car c’est de l’immensité dont nous avons peur
Au milieu des foins fous
au moment du départ
tu te souviens que dès ta naissance
entre les brèches et les fortifications
toutes tendresses anéanties
tu dressais les poings
Texte publié dans No 15. Chemins de vers. Poésie