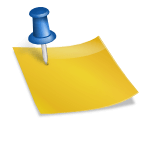C’est en nous que les paysages trouvent un paysage.
Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité
À une quinzaine de minutes à pied de chez moi, à Montréal, il y a un boisé. Ceinturé par un complexe sportif, un stationnement de Cégep et deux grandes artères sur lesquelles les voitures roulent trop vite, il a été grugé de toutes parts par le développement urbain. Mais une biodiversité remarquable y règne, et la flore de son sous-bois n’a rien à envier à un lieu sauvage situé à plusieurs heures de la ville.
Je m’y rends parfois avec mes écouteurs, que j’enfile pour traverser les avenues achalandées puis les petites rues résidentielles qui m’y mènent, mais je ne manque jamais de les ôter à la lisière de la forêt, comme on retire ses chaussures avant de pénétrer dans un temple. Mes pieds quittent la fermeté du béton et s’enfoncent dans la mollesse de son tapis. Les chemins que j’y sillonne se mêlent aux racines tortueuses des érables centenaires. L’air s’épaissit, le chuchotement dans les branches aiguise mon ouïe et je m’enfonce avec révérence dans ses sentiers sinueux.
Cet espace où je me rends en toute saison, comme en pèlerinage, a toutes les allures d’une forêt primitive. Mais ce qui en demeure est cultivé, comme un jardin, pour que la flore s’y épanouisse malgré les assauts des plantes envahissantes, malgré la destruction des écosystèmes. Il y a une dizaine d’années, le boisé a été restauré, comme une cathédrale laissée à l’abandon. On a éradiqué le nerprun cathartique, planté des milliers d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces et d’herbacées indigènes, créé des friches pour les pollinisateurs… Des brigades invisibles entretiennent ces lieux pour que puisse y foisonner une nature sauvage.
La végétation luxuriante du boisé est ancienne comme l’île elle-même – elle renferme des vestiges de la forêt originelle. C’est un milieu que les biologistes appellent un reliquat : un fragment de paysage resté intact tandis que le monde autour de lui s’est transformé.
*
Au creux de l’hiver, je m’envole pour une résidence à Arles, dans le sud de la France. Mais auparavant, je m’arrête à Paris, une ville où j’ai vécu il y a huit ans et dont ma mémoire refuse d’arpenter les rues, comme s’il y avait là une impasse, un refoulé. Je m’y rends donc à la reconquête de mes souvenirs, et je loue une chambre à deux pas du Jardin des plantes. Tous les matins, avant d’affronter les rues, j’erre dans ses allées. C’est l’endroit qui conserve mes souvenirs les plus apaisants, une sorte d’antidote à une ville quelquefois accablante.
Le Jardin des plantes, autrefois le Jardin royal des plantes médicinales, a été fondé sous Louis XIII pour former les futurs médecins et apothicaires. Au XVIIIe, on y acclimate des plantes exotiques rapportées de différentes expéditions. Buffon, le « prince des naturalistes », en doublera la superficie, puis s’ajoutera en pleine Révolution la Ménagerie, et on construira plus tard les grandes serres, le « grand jardin d’hiver » et le jardin alpin.
Nous sommes en février, et au cœur de l’hiver parisien, tout semble à la fois mort et prêt à revivre. Le jardin alpin est fermé pour le repos hivernal, alors je le contemple à distance, la tête entre les barreaux, pour apercevoir les premiers crocus et les perce-neige, comme d’autres se massent devant la clôture de la Ménagerie, à quelques pas, pour entrevoir les pandas roux et les wallabies au regard mélancolique qui partagent leur pitance avec les pigeons parisiens.
Dans la brume sèche du matin, au chant de la tourterelle triste, j’examine le frimas sur les feuilles de scutellaire, les gouttes de rosée sur la sauge. Les vols planés des corbeaux menacent de me frôler la tête. Plusieurs plantes mortes sont encore debout, squelettiques. Certaines sont à mi-chemin entre la mort et la vie – leurs tiges desséchées se bordent de feuilles nouvelles. Quelques arbres sont déjà en fleurs : l’arbre à papier, l’amandier amer, les buissons touffus de laurier-tin qui envahissent les clôtures. Mais les platanes sont encore nus, la peau glabre, les poings tendus vers le ciel.
Dans la roseraie, dont les boutons gonflés attendent d’éclore, je rencontre une masse stratifiée à l’allure minérale. Je passe la main sur la surface et découvre un grain singulier, à la fois lisse et rêche – quelque part entre l’arbre et la pierre. L’écriteau m’apprend que je me tiens devant un tronc de cyprès fossile. Il y a 30 millions d’années, la mer s’est retirée de la région et une forêt s’est développée au milieu des dunes. Ce tronc de cyprès pétrifié est une relique, un ossement de la forêt parisienne.
*
À Arles, la fenêtre de ma chambre donne sur le jardin intérieur d’un cloître. Fondé au xvie siècle et devenu hôtel-Dieu au xixe, le lieu est célèbre pour avoir accueilli Van Gogh au moment de sa crise arlésienne, celle qui l’a poussé à se mutiler. Devant l’entrée, une reproduction de son tableau « Le jardin de la maison de santé à Arles » affiche un paysage identique à celui qui se trouve sous mes yeux, à l’exception de la silhouette d’une religieuse se profilant sous les arcades. Un passage d’une lettre de l’artiste à sa sœur Wilhelmine accompagne le tableau, décrivant « un jardin antique avec un étang au milieu et huit parterres de fleurs, du myosotis, des roses de Noël, des anémones, des renoncules, de la giroflée, etc. » En ce moment, l’étang est à sec, et parmi les fleurs à bulbes, seules les jonquilles commencent à poindre.
Dans les cahiers de Félix Rey, le jeune médecin qui a soigné sur ces lieux la blessure de Van Gogh, on a retrouvé un croquis de son oreille montrant la trajectoire de la lame qui l’avait sectionnée. Le médecin immortalisé par le peintre lui avait donc aussi discrètement tiré le portrait. Le tracé délicat du dessin révèle un geste intime et attentionné qui me touche. Dans un élan qu’on dit parfois christique, Van Gogh avait offert son organe coupé à une jeune fille qu’il connaissait, une employée de maison close, sans doute une ménagère. Ceci est mon corps livré pour vous.
Van Gogh est omniprésent, ici, et même si on est comme moi cynique face aux tactiques de l’industrie du tourisme, il est difficile de ne pas être ému par sa correspondance, citée sur des panneaux installés un peu partout dans la ville. « Je crois que tu aimerais la chute des feuilles que j’ai faite », écrit-il à son frère Théo. « Ces troncs d’arbres comme des piliers bordent une allée où sont à droite et à gauche alignés de vieux tombeaux romains d’un lilas bleu. » Nous sommes aux Alyscamps – « champs Élysées » en provençal – une nécropole romaine située à l’écart de la cité antique, et sans doute l’un des espaces les plus arborés de la ville.
Je m’y rends donc comme dans un parc, un vestige de forêt. Car ce lieu a aussi été amputé d’une grande partie de son étendue, rogné à mesure qu’on a creusé des canaux et construit des voies ferrées. Sous le bitume que je traverse pour l’atteindre se trouve l’ancien site du Jardin d’hiver, lui-même érigé sur les décombres d’une colonie pré-romaine et qu’on a détruit pour bâtir un vaste stationnement. Je longe des remparts antiques au pied desquels prolifère un massif d’acanthes, celles-là mêmes qui ornent tant de colonnes arlésiennes, et qui poussent ici en friche.
Aux Alyscamps, je me promène seule parmi les tombeaux vides à ciel ouvert, éventrés, comme si les morts s’en étaient échappés, ou comme s’ils avaient été absorbés par le calcaire poreux des sarcophages, ces « mangeurs de chair ». Certains ont des visages sculptés dans la pierre, recouverts de mousses et de lichens, qui m’épient de leurs regards éplorés. Et parmi ces constructions sacrées se dresse une humble demeure profane : la maison du jardinier.
Au bout de l’allée bordée de cyprès m’attend une église romane partiellement en ruines. Elle renferme en son cœur un jardin accidentel, une nef inachevée à ciel ouvert. J’y entre par une porte latérale, et ses voûtes se succèdent dans la pénombre. Dans l’enceinte, à l’abri du soleil provençal, règne un froid pénétrant. Au son de mes pas, les pigeons s’envolent sous les arcades dans un vacarme qui me fait sursauter, puis se déposent et se pétrifient.
Tout au fond, une crypte qui renfermait autrefois des reliques. Car la nécropole s’est formée autour de la tête de saint Genest, un martyr local décapité. Des fidèles de partout se sont massés pour être inhumés à ses côtés, laissant une panoplie de restes humains dans les enfeus de l’église. À une dizaine de minutes à pied, à la cathédrale Saint-Trophime, je retrouverai le crâne du saint, posé sur un coussin de velours brodé de fil d’or et entouré d’une quantité stupéfiante d’ossuaires de toutes sortes. De l’autre côté du transept, une chapelle entière est dédiée à une goutte de sang de Jean-Paul II. Le culte des reliques, après tout, n’est pas que chose du passé.
En 2014, une artiste néerlandaise a créé une « réplique vivante » de l’oreille de Van Gogh à partir de son ADN et de celui d’un descendant, l’arrière-petit-fils de Théo, une œuvre imprimée en 3D et faite de tissus de cartilage. Les visiteurs de l’installation peuvent venir lui murmurer des mots doux et des secrets, qu’elle enregistre et rediffuse.
Entre le crâne de saint Genest, qui a engendré une forêt-nécropole, et l’oreille de Van Gogh, dont le spectre plane sur la cour du cloître et hante encore les esprits, les jardins arlésiens sont de véritables reliquaires.
*
Le terme relique vient du latin reliquiae, les restes, les survivants, du verbe relinquere, laisser derrière soi. La relique est rémanence, la marque à la fois de ce qui n’est plus et de ce qui perdure. Ce qui demeure après la disparition. Les ossements des saints, bien sûr, et tous ces autres restes humains auxquels on voue un culte sacré comme profane, mais également un tronc pétrifié qui témoigne d’une forêt ayant existé il y a des millions d’années, ou un fragile écosystème conservant les traces d’un paysage millénaire.
Après toutes ces pérégrinations, je reviendrai à l’aube du printemps dans ma ville encore enneigée. Dès l’arrivée des beaux jours, je referai mon pèlerinage vers le boisé et m’agenouillerai sur la mousse humide pour surveiller la floraison des sanguinaires et des érythrones d’Amérique. J’arpenterai les sentiers jusqu’à repérer mon premier arisème petit-prêcheur, m’adonnant à mon propre culte des reliques, à l’adoration de ce fragment de paysage qui subsiste près de chez moi.
Luba Markovskaia
publié dans le numéro 34. Jardins divers
Image : Marika Drolet Ferguson VM01 à 10, numérisation d’une pellicule 35mm couleur, 2014